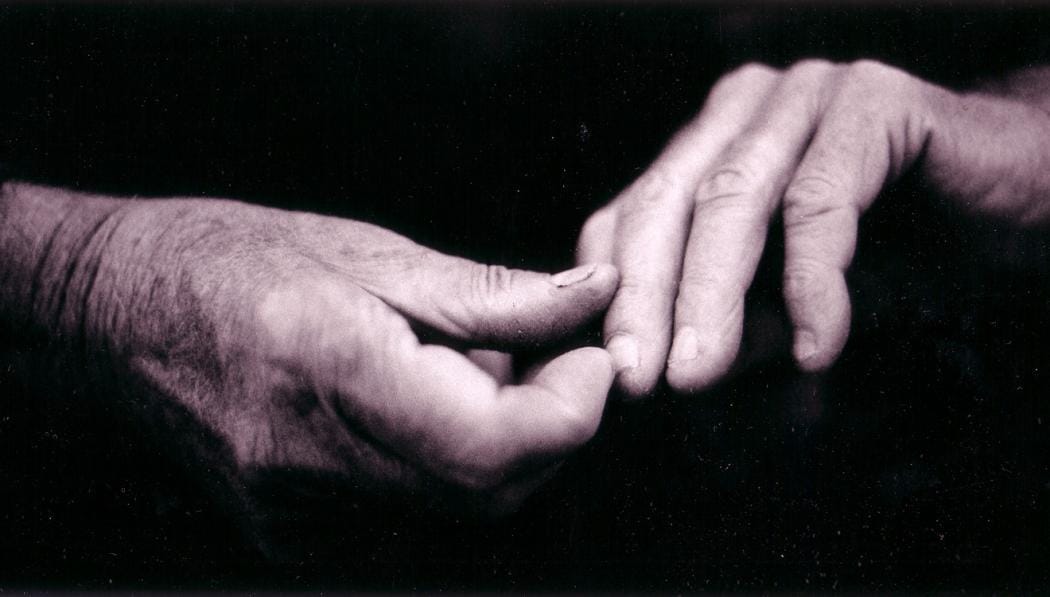par Shanned Morales | Sep 11, 2022 | Environnement, Québec
Depuis le 1er mars 2022, le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral exige la mise en place d’une bande riveraine d’au moins dix mètres pour protéger les cours d’eau, les habitats et la faune. Mais, pour la COGESAF (Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François), la seule installation d’une bande riveraine ne suffirait pas à prévenir l’érosion du sol et la dégradation de la qualité de l’eau. Il faudrait aussi promulguer des bonnes pratiques agricoles pour maximiser l’efficacité des bandes riveraines.
Les bénéfices des bandes riveraines
Les bandes riveraines sont des barrières naturelles laissées en bordure des cours d’eau afin de les protéger de la contamination causée par les pesticides et les résidus des activités agricoles.
Selon un article[i] publié sur le site Web Québec Vert, l’implantation d’une bande riveraine apporte des avantages à l’environnement. Notamment, elles favorisent le recyclage des résidus organiques filtrés, le maintien de la qualité de l’eau, la stabilisation du sol, en plus de fournir un abri et des aires de reproduction pour la faune. D’après M. Nicolas Bousquet, biologiste et coordonnateur de projets terrain de la COGESAF[ii], « la bande riveraine est un outil efficace. C’est assez simple, on doit voir la bande riveraine comme un filtre et une éponge qui va absorber les nutriments, réduire l’érosion et capter les sédiments. ».
Les bonnes pratiques agricoles sont importantes
M. Bousquet croit néanmoins que la manière de cultiver à une incidence au moins aussi importante sur la protection de l’eau et de l’environnement. « Le milieu agricole doit améliorer ses pratiques en matière des bandes riveraines », affirme-t-il, dénonçantles mauvaises pratiques agricoles. « Un gazon vert avec l’utilisation d’engrais ou des installations septiques non conformes en bordure de plan d’eau, ne sont pas l’idéal pour la qualité de l’eau ». Selon un article de l’Union des producteurs agricoles (UPA)[iii], les bonnes pratiques agricoles combinées avec une gestion adéquate de la bande riveraine peuvent réduire les pertes du sol jusqu’à 85 %. Cette combinaison aurait également un impact positif sur la qualité de l’eau et la biodiversité. « L’implantation d’une bande riveraine, combinée avec de bonnes pratiques culturales, constitue une des mesures à privilégier pour freiner l’érosion », est-il écrit dans l’article de l’UPA..
Un bassin sédimentaire serait une bonne idée
M. Michel Brien,[iv] président de l’UPA, souligne de son côté que les bandes riveraines, en tant que barrières naturelles, protègent la faune aquatique, terrestre et le sol, mais la création d’un bassin sédimentaire – une dépression de la croûte terrestre qui retient des sédiments provenant des activités agricoles et de la construction – pourrait faire une bonne équipe avec les bandes riveraines. D’après M. Brien, un bassin de sédimentation en tant que filtre peut réduire la quantité de sédiments qui se jettent dans l’eau. « Lorsqu’on fait des travaux, il serait important de végétaliser et aussi de faire un bassin de sédimentation. », déclare-le président. Selon un article sur les bandes riveraines publié par l’UPA, cette dernière sert de tampon pour retenir les sédiments emportés par le ruissellement, en plus d’agir comme haie brise-vent, tandis qu’un bassin de sédimentation est plus utile pour la filtration de sédiments. Leur utilisation conjuguée aurait un impact significatif sur la qualité de l’eau et la conservation de la faune.
« Si tout le monde montrait l’exemple… »
M. Bousquet et M. Brien soulignent que toutes les parties doivent travailler ensemble pour protéger l’environnement. M. Bousquet envoie d’ailleurs un message aux autorités environnementales et aux agriculteurs : « J’aimerais préciser que les autorités devraient respecter la règlementation. Je vois le problème en deux parties. Certains producteurs ne respectent pas les règlementations, mais aussi certaines municipalités/MRC font peu pour appliquer la règlementation et ont parfois une vague idée de ce qui se passe dans leur territoire ». M. Brien partage cette même pensée. « Des deux côtés, parfois, il y a des agriculteurs qui ne font pas attention, mais il y a aussi des municipalités qui ne font pas attention non plus », ajoute-t-il. Il déclare que tout le monde devrait montrer l’exemple.
Des aides financières offertes
Une bande riveraine peut coûter cher pour certains producteurs agricoles. Notamment, des frais pour les plantes herbacées, le transport, l’installation de paillis, la collerette et la pose sont à prendre en compte, alors que le coût d’une bande riveraine arbustive est d’au moins 7,35 $ le mètre linéaire tandis que celui d’une bande riveraine arborescente s’élève entre 9,85 $ et 20,85 $ le mètre linéaire en plus des frais d’entretien Le cas de M. Brien est exceptionnel, car la végétation pousse naturellement sur son terrain. Il affirme que, jusqu’à présent, il n’a pas eu à débourser beaucoup pour des bandes riveraines. Afin de venir en aide aux producteurs devant défrayer les coûts d’installation des bandes riveraines, il explique qu’il exeste des subventions comme le Programme Prime-Vert qui offre des allocations aux agriculteurs dépendamment de la situation. Particulièrement, les bandes riveraines de plus de trois mètres peuvent être financées et les demandeurs ont droit à un cumul de dépenses admissibles de jusqu’au 40000 $[v]. Gestrie Sol[vi] agroenvironnement a publié un guide sur les bandes riveraines qui décrit leurs avantages, les types existants, ainsi que les subventions offertes lors de leur aménagement. Selon le document, aménager une bande riveraine peut poser quelques difficultés en fonction des conditions du terrain, telles que l’érosion du sol ou un muret de soutènement détérioré. Lorsqu’un producteur rencontre ces difficultés, il peut faire appel à des conseillers[vii] du Club-conseil en agroenvironnement, du réseau Agriconseils, ou encore du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ).
Le gouvernement devrait s’impliquer davantage
Selon M. Louis-Gilles Francoeur et M. Jonathan Ramacieri, auteurs du livre La caution verte[viii], en 1991, le gouvernement du Québec a octroyé le pouvoir aux municipalités de surveiller les cours d’eau situés sur leur territoire. La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) visait initialement à protéger les sources d’eau potable et à mettre en vigueur certaines restrictions pour les activités agricoles. Toutefois, M. Francoeur déclare dans son livre que les politiques ne sont pas assez sévères. « La protection des bandes riveraines en milieu agricole s’est d’ailleurs avérée une coquille vide depuis le début du PAEQ (Programme d’assainissement des eaux du Québec) ,et ce, malgré l’adoption d’une politique d’application gouvernementale pour les MRC » souligne-t-il. L’Esprit libre a communiqué avec M. Louis-Gilles Francoeur quia confirmé cette affirmation : « Il n’existe pas de règlements provinciaux, mais des règlements de MRC, de municipalités régionales de comté, qui ont le pouvoir de règlementation sur l’aménagement et la protection des bandes riveraines. », affirme-t-il. M. Francoeur signale que les MRC ont le devoir de s’assurer que les agriculteurs respectent les normes. « Les MRC le font très peu, pour une raison : ce ne sont pas elles qui vont toucher l’argent, l’argent va aller au gouvernement du Québec, et les municipalités vont devoir payer des frais d’avocat ; elles n’ont pas d’intérêt financier à faire respecter ces règlements », conclut-il.
Les municipalités pas assez impliquées
Lors de notre entrevue avec M. Michel Brien, celui-ci a dénoncé que les municipalités elles-mêmes ne respectent pas les règlementations. « Ici [un chemin près d’un cours d’eau à Racine] quand ils ont refait le chemin il y a deux ans, ça a été supervisé par un ingénieur, mais complètement étroit, ça ne respectait pas les règlements. Ici, le foin a poussé il y a deux ans, mais avant ils ont laissé le chemin seul, à nu, et cela a fait de l’érosion. Il n’y pas de bassin de sédimentation, rien », raconte-t-il.
Le ministère de l’Environnement et les réglementations
Les intervenants que nous avons rencontrés ont souligné qu’il manque d’intervention de la part du gouvernement du Québec. L’Esprit libre a communiqué avec le ministère de l’Environnement pour avoir des réponses à certaines questions sur la réglementation des bandes riveraines[ix]. Selon le ministère, le 1er mars 2022 l’ancienne politique de bandes riveraines a été remplacée par le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Selon l’article 2 du chapitre 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement[x], le ministre de l’Environnement peut mettre en place des plans de protection et de conservation environnementaux. Il doit également assurer la surveillance de la qualité de l’environnement au Québec, notamment la gestion des eaux usées et la réduction de rejet de contaminants provenant des industries. Par ailleurs, selon le ministère, le gouvernement du Québec et les municipalités travaillent ensemble pour la protection de l’environnement. « Selon l’article 117 de ce nouveau régime, la municipalité peut toutefois continuer de faire appliquer une réglementation concernant la végétation en rive. Le ministère effectue des activités de contrôle dans divers milieux et domaines, dont le milieu agricole », affirme-t-il. Ainsi, selon ces déclarations, les municipalités s’assurent de veiller à la réglementation des bandes riveraines, tandis que selon M. Bousquet et M. Brien, les MRC ne font pas un bon travail de surveillance. Du côté des travailleurs agricoles récalcitrants, le ministère détaille les amendes auxquelles ils peuvent incomber : « Lorsque des non-conformités à la réglementation en vigueur sont constatées par le contrôle environnemental, les manquements sont alors traités conformément aux dispositions prévues à la Directive sur le traitement de manquements à la législation environnementale » détaille-t-il. Selon le ministère, en plus des amendes, celui-ci peut infliger des sanctions aux récalcitrants : une sanction pénale ou une sanction administrative ainsi que la révocation de l’autorisation environnementale.
CRÉDIT PHOTO: Shanned Morales
[i] Fédération interdisciplinaire de l’Horticulture du Québec, « Guide de bonnes pratiques, Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines », 29 juillet 2022, http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_we…
[ii] Nicolas Bousquet COGESAF, propos recueillis par Shanned Morales le 28 juillet 2022.
[iii] Union des producteurs agricoles, « à quoi sert une bande riveraine ? », 28 juillet 2022, https://www.bandesriveraines.quebec/a-quoi-sert-la-bande-riveraine/
[iv] Union des producteurs agricoles, propos recueillis par Shanned Morales le 28 juillet 2022.
[v] Agrobonsens, « Bande riveraine élargie », 15 août 2022, http://agrobonsens.com/technique/bande-riveraine-elargie/
[vi] Gestrie Sol Agroenvironnement, « À chacun sa bande riveraine, Guide de bandes riveraines en milieu agricole », 2014, https://www.bandesriveraines.quebec/wpfb_filepage/14_a-chacun-sa-bande_catalogue-gestrie-sol-2013-pdf/
[vii] Union des producteurs agricoles, « Vos conseillers », 28 juillet 2022, https://www.bandesriveraines.quebec/vos-conseillers/
[viii] Louis-Gilles Francoeur et Jonathan Ramacieri, la caution verte, Québec : Écosociété, 2022
[ix] Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, propos recueillis par Shanned Morales le 11 août 2022.
[x] Loi sur la qualité de l’environnement, C-2, art. 2, 2022
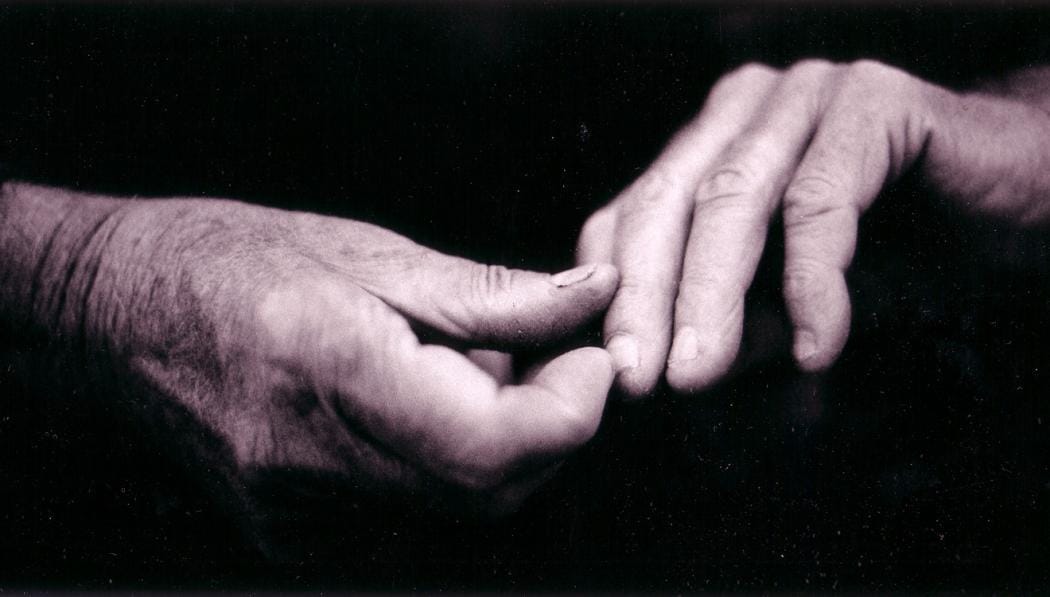
par Shanned Morales | Août 14, 2022 | Opinions
Les aîné·e·s sont plus vulnérables dans une situation de maltraitance. Cela est d’autant plus vrai si les aînés sont maltraité·e·s par leurs enfants ou par un autre membre de leur famille. La crainte et la honte provoquent un mutisme chez les personnes âgées, mais aussi des problèmes de santé physique et mentale. Pour répondre aux besoins des aîné·e·s, des organismes communautaires offrent un accompagnement gratuit et confidentiel.
Lorsqu’on parle d’aîné.e.s, les CHLSD nous viennent en tête, car la plupart des personnes âgées habitent dans des centres d’hébergement pour aîné.e.s. Toutefois, certain.e.s aîné.e.s décident de rester dans leurs foyers avec leurs familles. Un lieu où illes peuvent aussi subir de la maltraitance de la part de leurs proches, qui peuvent tirer profit de la vulnérabilité de leur parent ou grand-parent.
Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (1), en 2016, 4 % à 7 % des aîné.e.s ont été victimes de violence au Québec. Et certain.e.s d’entre elleux ne dénonçaient pas leur agresseur.euse.
« Différents motifs expliquent cette situation, tels que la peur des répercussions d’une dénonciation, les sentiments de honte, de culpabilité, d’humiliation, de tristesse, de colère, la dépendance à l’égard de la personne maltraitante, la perte d’autonomie […] », est-il écrit dans le rapport du ministère de la Famille. La plupart du temps, les aîné.e.s ne sauraient pas reconnaître les signes d’alarme, que ce soit parce qu’illes ne jouissent pas de toutes leurs facultés, ou parce que les comportements sont perçus comme normaux.
Selon l’article Maltraitance envers les personnes aînées publié par le gouvernement du Québec (2), la maltraitance envers les aîné.e.s peut avoir des répercussions graves sur leur santé physique et mentale et peut entraîner une faible estime de soi, des séquelles physiques et psychologiques. Dans certains cas, l’aîné.e maltraité.e peut vouloir mourir plus tôt ou tenter de s’enlever la vie.
Lucie Caroline Bergeron est directrice générale du DIRA Estrie (dénoncer la maltraitance, informer, référer, accompagner les aîné.e.s) (3), et intervenante auprès des aîné.e.s qui subissent de la maltraitance. Elle explique que les types de maltraitance les plus dénoncés au DIRA sont la maltraitance psychologique et la maltraitance financière.
La première se traduit par le chantage, la manipulation et le harcèlement. La deuxième est le fait de voler l’argent de l’aîné.e et de négliger ses besoins en nourriture ou ses dépenses personnelles.
Les femmes, les plus visées
Selon les données présentées par le ministère de la Famille, les personnes âgées ayant des pertes d’autonomie sont plus fréquemment victimes de maltraitance. Et la situation est plus grave pour les femmes. Des données de la Ligne Aide Abus Aînés (4) trouvées dans un document du ministère de la Santé et des Services sociaux confirment que la proportion de femmes victimes de violence est majeure; une probabilité qui peut augmenter avec l’âge de la personne. Parmi les 5 à 7 % d’aîné.e.s victimes de maltraitance au Québec, 71 % étaient des femmes et étaient 24 % des hommes.
Selon un article sur la maltraitance publié par le gouvernement du Québec, certains facteurs pourraient augmenter le risque de maltraitance : la solitude, le faible revenu, l’alcoolisme, la dépendance d’un membre de la famille, la maladie ou la perte d’autonomie.
Pour que les choses changent, de plus en plus de personnes commencent à dénoncer la violence envers les personnes âgées. Le 15 juin, des communautés partout dans le monde se mobilisent lors de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aîné.e.s, pour sensibiliser la population aux comportements violents et promouvoir la bientraitance. Le 12 juin 2022, le gouvernement du Québec a lancé un plan d’action pour lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées. Cette initiative a pour but d’aider les aîné.e.s qui souffrent en silence.
Les proches, les premiers agresseurs
La plupart du temps, la victime cohabite avec l’agresseur.euse. Pour cette raison, ille craint de la.le dénoncer, parce qu’on l’a menacé.e ou que l’agressé.e ne veut pas faire de tort à son proche.
Selon Lucie Caroline Bergeron du DIRA, même si la collectivité croit que la maltraitance envers toute personne ne se justifie pas, elle peut s’expliquer : une personne maltraitante pourrait avoir subi de la violence dans le passé, et elle peut penser que maltraiter les autres est normal. « Si la personne maltraitante maltraite une personne âgée, c’est que quelque part, elle vit un problème. Elle peut rencontrer des difficultés en matière financière ou en matière de dépendances », détaille-t-elle.
Ainsi, la personne maltraitante agresse son proche vulnérable et lui vole de l’argent parce que c’est plus facile, et si jamais le.la maltraité.e refuse d’en donner, on le.la maltraite physiquement ou émotionnellement. Les statistiques de la Ligne Aide Abus Aînés présentées par le ministère de la Santé et des Services sociaux démontrent que 38 % des agresseur.euse.s sont les enfants de l’aîné.e et que 12 % sont des membres de la famille.
À l’heure actuelle, les aîné.e.s ne sont en sécurité ni à la maison ni dans les CHLSD. Et ce seraient l’âge et la perte d’autonomie qui mettraient en danger leur sécurité et leur bien-être. Dans un article publié le 22 juin 2022, le Journal de Montréal (5) rapporte la maltraitance dont l’ensemble des résident.e.s d’un CHLSD à Granby sont victimes. Une résidente aînée âgée de 100 ans n’a pas été nourrie et est restée dans son lit pendant une journée entière. La situation de cette personne n’est pas unique : en décembre 2021, 24,7 % des motifs de plaintes étaient liés à la maltraitance dans l’ensemble du CIUSSS de la Mauricie-et-le-Centre-du-Québec.
Parler pour s’aider
Face à la maltraitance de la part des proches, le DIRA tente d’abord de permettre à la personne de trouver les forces et la volonté de demander de l’aide de son plein gré. Si la personne maltraitée décide de prendre la parole, le DIRA pourra la référer à la police, au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et à d’autres partenaires qui offrent du soutien aux victimes de maltraitance. Cela permettra à la victime d’être accompagnée par un.e intervenant.e. Chacun.e peut choisir les modalités des rencontres (heures, lieux, etc.).
Mme Bergeron du DIRA envoie un message aux personnes maltraitées et maltraitantes : « Pour régler un problème, il faut en parler. Et on peut choisir la personne à qui on parle, en qui on a confiance ». Elle explique que cela peut être un.e ami.e, un.e intervenant.e, un.e infirmier.ère, ou un membre du personnel de soins. « Cela permet au moins de décharger cette lourdeur qui nous habite. En parler fait déjà un grand bien », conclut-elle. Au Québec, maltraiter une personne constitue un délit, peu importe l’âge ou le statut social. S’il n’existe pas d’accusation spécifique criminalisant la maltraitance des aîné.e.s, les agresseur.euse.s peuvent être accusé.e.s d’homicide involontaire, de fraude, de braquage à domicile, etc.
Les proches aidant.e.s qui soutiennent les victimes de maltraitance
Selon Mme Bergeron, le fait d’être elle-même intervenante et proche aidante de ses parents lui permet de connaître les besoins des autres aîné.e.s et de les référer à des organismes qui offrent du soutien, notamment le Réseau de la santé et des services sociaux. Un.e conjoint.e, un.e ami.e, un.e enfant, un.e bénévole, un.e proche aidant.e, ou encore un.e aidant.e naturel.le peuvent être des anges gardiens pour la personne âgée, de par le soutien et la compagnie qu’illes lui procurent. « Un.e proche aidant.e est toute personne qui accompagne une autre personne en perte d’autonomie en raison d’une incapacité permanente ou temporaire notamment, comme le diabète, la maladie d’Alzheimer ou un cancer », selon Mélinda Pepin, intervenante au sein du Réseau d’Amis de Sherbrooke (6). Cette personne peut ou peut ne pas avoir suivi une formation en proche aidance. « On peut avoir des qualités professionnelles en matière d’intervention, mais on ne peut s’improviser et être intervenant du jour au lendemain. C’est une problématique assez complexe », explique Mme Bergeron.
Si un.e proche aidant.e veut suivre une formation, ille peut s’inscrire auprès de l’Appui pour proches aidants, un organisme à but non lucratif qui offre un accompagnement aux proches aidant.e.s. Selon Gwladys Sebogo, conseillère en développement régional en Estrie, cette institution offre du soutien aux proches aidant.e.s qui veulent savoir comment prendre soin d’une personne âgée. Illes peuvent contacter la ligne Info-aidant en cas de doute.
Les proches aidant.e.s ont elleux aussi besoin d’aide
Les personnes aidant.e.s peuvent aussi vivre aussi des moments difficiles dans leur vie personnelle ou professionnelle. Dans de tels cas, Mélinda Pepin, intervenante au sein du Réseau d’Amis de Sherbrooke, recommande de se faire aider : « Il faut sensibiliser les proches aidant.e.s à leur réalité et travailler sur leur sentiment de perfectionnisme », explique-t-elle à propos des aidant.e.s naturel.e.s qui se sentent coupables de ne pas pouvoir apporter plus d’aide aux personnes à leur charge.
Selon la Fondation proches-aimants Petro–Canada (7), 51 % des aidant.e.s naturel.e.s se sentent épuisé.e.s mais ne le disent pas, de peur d’être jugé.e.s par les autres. La fondation tente ainsi de sensibiliser les Canadien.e.s aux réalités des proches aidant.e.s pour mieux les soutenir. Le premier mardi d’avril, on célèbre la Journée nationale des proches aidant.e.s. C’est l’occasion de reconnaître le travail que ces personnes font pour les aîné.e.s, et d’offrir tout l’appui dont les aidant.e.s ont besoin pour retrouver la paix et l’estime de soi.
Le Réseau d’Amis recommande aux proches aidant.e.s éprouvant des sentiments de culpabilité, de tristesse ou d’impuissance de communiquer avec les organismes communautaires de leur région. La ligne Info-aidant peut les référer aux services disponibles dans leur région.
Pour en savoir plus :
Si vous êtes une personne aînée victime de maltraitance de n’importe quel type, ou que vous connaissez quelqu’un qui en subit, contactez le DIRA ou la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287.
CRÉDIT PHOTO: Rebecca Sampson – flickr
1. Gouvernement du Québec, Reconnaître et agir ensemble, plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2022, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-48W.pdf
2. Gouvernement du Québec, « Maltraitance envers les personnes aînées, » 15 juillet 2022, https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/maltrai…
3. DIRA- Estrie, propos recueillis par Shanned Morales, le 13 juillet 2022
4. SAVA, Soutien d’aînés victimes d’abus, « Conséquences de la maltraitance, » 18 juillet 2022, https://maltraitance.org/2017/11/14/consequences-de-la-maltraitance/
5. Agence QMI, « Granby: de mauvais traitement dans un CHLSD persistent malgré un rapport accablant » Le Journal de Montréal 22 juin 2022, https://www.journaldemontreal.com/2022/06/28/granby-des-mauvais-traitements-dans-un-chsld-persistent-malgre-un-rapport-accablant
6. Réseau d’Amis de Sherbrooke, propos recueillis par Shanned Morales, le 15 juillet 2022
7. Fondation proches aimants Petro-Canada, « Les proches aidants au Canada : orienter une conversation nationale : enjeux et occasions, » 20 juillet 2022. (Document PDF).

par Shanned Morales | Avr 19, 2022 | Analyses, Societé
La pénurie de main-d’œuvre s’accentue dans le secteur de la santé, le manque de personnel entraîne des répercussions graves sur le milieu hospitalier et la surcharge de travail affecte la santé physique et mentale des employé·e·s. En même temps, on essaie de combler ce manque en recrutant des travailleur·e·s immigrant·e·s, mais les délais nécessaires pour entreprendre de telles démarches découragent certain·e·s candidat·e·s étranger·e·s qui finissent par abandonner.
La COVID-19 fait un retour prématuré
C’est l’été et la plupart des gens veulent profiter du soleil et faire des barbecues sur le balcon avec leur famille. Toutefois, à cause de l’arrivée de la 7e vague de COVID-19, les travailleur·euse·s de la santé ne peuvent pas se le permettre. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, l’arc-en-ciel disparaît, la surcharge de travail et l’épuisement professionnel arrivent en force. Jusqu’à présent, le nombre d’éclosions chutait en été et le virus faisait son retour en automne. Toutefois, cette année, cela n’a pas été le cas. Pour cette dernière vague seulement, on dénombre 2027 cas en Estrie (1), ce qui fait augmenter la pression sur les travailleur·euse·s, qui effectuent déjà de longues heures sans avoir le temps de bien se reposer. Tout cela est difficile à accepter pour les travailleur·euse·s en milieu hospitalier, qui éprouvent une fatigue accumulée et montrent une insatisfaction face à la gestion des dirigeant·e·s du CIUSSS de l’Estrie.
La Fédération de la santé et des services sociaux fait le point
L’Esprit libre a communiqué avec monsieur Régin Leclair, porte-parole de la Fédération de la santé et des services sociaux (2) pour lui demander son avis sur les conditions de travail en milieu hospitalier. Il souligne que ces dernières sont difficiles : « C’est une situation périlleuse. Il faut protéger les employé·e·s », déclare-t-il. De plus, M. Leclair affirme qu’il faut donner le droit aux employé·e·s d’être consulté·e·s sur les décisions prises dans leur milieu de travail, « il faut que le[ou la] travailleur[·euse] ait son mot à dire », ajoute-t-il. Les travailleur·euse·s de la santé veulent travailler dans un milieu où ielles sont en mesure de concilier la vie au travail et la vie en famille. Selon les affirmations du porte-parole, les employé·e·s cherchent à améliorer leur horaire, leur salaire et leur milieu de travail. Dans un monde idéal, en recrutant plus de personnel, on pourrait bien s’occuper des patient·e·s et passer plus de temps en famille. Nous avons posé à M. Leclair la question de savoir quel serait le milieu de travail idéal pour les employés du secteur hospitalier. Il a répondu que, afin de soigner les patient·e·s humainement, de prévenir la fatigue et les blessures au travail, il faudrait un·e employé·e pour 10 patient·e·s.
Par ailleurs, la Fédération de la santé de services sociaux continue de déployer des efforts pour améliorer les conditions de travail du milieu de la santé. Un article sur le site Web de la Fédération nous informe que les délégué·e·s de la Fédération se sont rassemblé·e·s en mai et en juin pour discuter des revendications des travailleur·euse·s du secteur public. Le syndicat cherche à négocier de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et défendre les droits des employé·e·s.
Le guide « Qualité de vie au travail » une solution proposée
En mai dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a proposé un nouveau programme de conciliation entre la vie personnelle et le travail (3), qui a pour but de générer un climat de travail plus agréable. Ce guide s’adresse aux entreprises québécoises et vise à les conscientiser aux bienfaits d’une bonne qualité de vie au travail. Le programme de qualité de vie au travail consiste à créer des incitatifs pour le personnel de travail pour réduire le présentéisme et l’absentéisme dans les secteurs plus ciblés par la pénurie de travailleur·euse·s. Selon le guide, les entreprises devraient installer des distributrices de collations santé et mettre en place des programmes pour inviter à des bonnes habitudes de vie et leurs répercussions sur la vie du personnel soignant. Toutefois, selon les affirmations du porte-parole de la Fédération de la santé et des services sociaux, le plan d’action proposé dans le guide semble irréaliste, puisque la cause principale de mauvaises conditions dans le milieu hospitalier est la surcharge de travail et non l’absence de salles d’entraînement ou d’un menu santé.
Plan « conciliation vie personnelle-vie professionnelle » du CIUSSS
De son côté, Marc-Antoine Rouillard, directeur adjoint des ressources humaines, communications et affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie (4), affirme que la direction a adopté un plan de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour améliorer la satisfaction des employé·e·s au travail. Entre autres, le programme d’aide aux employés (PAE) (5) offre du soutien aux membres du personnel qui éprouvent de l’anxiété en raison de la pandémie et deux programmes d’activités de santé physique et psychologique annuels, gratuites et qui se déroulent chaque année à midi et en fin de journée et pendant lesquelles les employé·e·s peuvent s’entraîner en plein air, faire du yoga ou danser la Zumba.
M. Rouillard souligne aussi que, selon un sondage récent, le niveau de satisfaction du personnel a augmenté de 30 %. De plus, le CIUSSS a recruté 160 adjoint·e·s administratifs de plus pour soutenir le personnel soignant. Il existe également un sondage sur l’expérience des employé·e·s qui permet à la direction de connaître les motifs de départ des employé·e·s et, selon le directeur adjoint de ressources humaines, les employé·e·s quittent le milieu parce qu’ielles se sentent épuisé·e·s et parce qu’ielles ne s’entendent pas bien avec leurs collègues de travail.
Les conséquences de la difficulté de concilier vie familiale et travail
Le fait de travailler des heures supplémentaires peut avoir des incidences négatives sur la vie physique et mentale des travailleur·euse·s. Selon un document publié le 3 juin 2022 par Statistique Canada (6), le manque de conciliation entre la vie familiale et le travail peuvent avoir des répercussions sur la santé : « ressentir davantage de stress au travail (86,5 %), avoir une charge de travail plus lourde (74,6 %) ainsi que devoir accomplir des tâches différentes de celles qu’ils font en temps normal (55,5 %) ». Les données citées dans ce paragraphe expliqueraient les motifs de départs des travailleur·euse·s de la santé du CIUSSS de l’Estrie, qui doivent travailler un surplus d’heures pour combler le manque de personnel. Par rapport aux relations avec leurs collègues, on peut dire que le personnel soignant croit que leurs dirigeants ne gèrent pas bien la distribution de tâches et que cela peut accroître les tensions au sein du milieu de travail. Par conséquent, la pénurie de travailleur·euse·s s’accentue et il faut avoir recours aux professionnel·le·s de l’étranger, qui seraient censé·e·s prêter main-forte en milieu hospitalier.
Recrutement des travailleur·euse·s immigrant·e·s pour pallier la pénurie de main-d’œuvre
La pénurie de main-d’œuvre n’est pas un enjeu social récent. On commençait déjà à en parler dans les années 2000, quand les chef·fe·s d’entreprises ont commencé à constater le vieillissement de la population active. Le gouvernement du Québec a alors proposé l’immigration comme solution à la pénurie de main-d’œuvre au Québec. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est responsable de la sélection des travailleur·euses immigrant·e·s qui viennent s’installer au Québec. Selon l’étude intitulée Travailleurs immigrants et SST au Québec (7), le système de sélection des immigrant·e·s se fait par un système de pointage qui tient en compte de leur profession, de leur niveau de scolarité, de leur expérience professionnelle et de leur niveau de français. Des données d’Immigration Québec montrent que, en 2021, entre 19 400 et 22 400 immigrants·e·s de la catégorie des travailleur·euse·s qualifié·e·s ont été admis·e·s au Canada. Alors, force est de se demander où sont tous ces travailleur·euses en pleine pénurie de main-d’œuvre? Si on accepte des candidat· e·s potentiel·e·s pour travailler au Canada, pourquoi continue-t-on de manquer de personnel? La réponse est simple : le secteur public veut embaucher des candidat·e·s ayant obtenu leurs diplômes d’études professionnelles au Québec. Si un·e postulant·e n’a pas fait ses études secondaires et supérieures au Québec, ielle doit soumettre une demande d’évaluation comparative des études effectuées au Québec. Cela dit, même les postulant·e·s qui reçoivent le document qui atteste l’équivalence ne sont pas au bout de leur peine. Afin d’effectuer un travail qui relève d’un ordre professionnel, ielles doivent obtenir un permis. Par exemple, un·e infirmier·ère qui a obtenu son diplôme hors du Québec doit, en premier lieu, envoyer une demande d’équivalence et, par la suite, se procurer un permis d’exercice auprès de l’Ordre des infirmières et infirmières du Québec. Le fait de devoir entreprendre une telle démarche si chronophage pour faire reconnaître ses études font en sorte que plusieurs candidat·e·s se découragent et abandonnent avant de pouvoir mener à bien les démarches nécessaires, et ce, dans le secteur de la santé, l’un des plus touchés par la pénurie de main-d’œuvre.
Par ailleurs, le 17 juillet dernier, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants a organisé une marche pacifique contre le racisme systémique envers les immigrants, qui travaillent ou non et qui ont un statut irrégulier au Canada. Selon un article intitulé « Un statut pour tous et toutes… EN FIN » (8), publié sur le site Web de l’organisme, les travailleur·euse·s immigrant·e·s devraient obtenir un statut légal, car ielles ont, pour la plupart, prêté main-forte aux premières lignes d’intervention pendant la pandémie. Néanmoins, plusieurs ont été expulsé·e·s du Canada sans justification. En posant tant d’obstacles aux travailleur·euses, la bureaucratie laisse le réseau de la santé se précariser petit à petit.
La bureaucratie et le recrutement du personnel
Même si les ordres professionnel·e·s ont le devoir de remettre des permis d’exercice aux travailleur·e·s québécois·e·s et aux travailleur·euse·s étrangèr·er·s, les délais de traitement des demandes de permis d’exercice sont beaucoup plus longs pour les candidat·e·s immigrant·e·s qui ont fait leurs études à l’extérieur du Canada. Selon une étude menée par Hélène Dubois, sociologue à l’Université Laval, les travailleur·euse·s immigrant·e·s qualifié·e·s éprouvent des difficultés à accéder au marché de travail québécois. Dans son article « Les enjeux de la reconnaissance professionnelle au Québec », elle énumère les obstacles rencontrés lors de la demande d’un permis auprès d’ordre professionnel : 1) la réticence de l’ordre à reconnaître les études de l’aspirant·e; 2) l’examen de français que les aspirant·e·s doivent réussir afin d’obtenir le permis; 3) le délai de traitement trop long. Madame Dubois explique également ce qui entraîne d’abandon de certains candidat·e·s. « L’accueil de travailleur·e·s qualifié·e·s s’inscrit en fait dans un continuum de démarches auprès de divers ministères, organismes et acteurs du marché de l’emploi », souligne-t-elle. En effet, les travailleur·e·s immigrant·e·s doivent faire preuve de patience pour communiquer avec les institutions concernées pour avoir « plus de chances » d’améliorer leur niveau de français et de trouver un bon emploi. En réalité, la plupart des demandeur·euse·s n’obtiennent pas le permis d’exercice régulier, mais un permis restrictif ou temporaire.
De surcroît, madame Dubois fait le bilan de la proportion de candidat·e·s qui passe au travers des démarches. « Pour l’ensemble des ordres, on estime qu’environ 50 % des candidat·e·s soumis à une prescription d’un ordre abandonnent la démarche d’admission, ce qui représente près de 1300 personnes par année », estime-t-elle. C’est là évidemment une cause de la pénurie de main-d’œuvre. Récemment, le ministre Jean Boulet a fait part son intention de recruter 1000 infirmier·ères de l’étranger. Combien de ces personnes vont persévérer jusqu’à l’obtention des équivalences et de leurs permis? Assouplir les restrictions pour l’obtention de permis auprès des divers pourrait donc être une solution pour pallier le manque de main-d’œuvre.
Enfin, l’inefficacité de la bureaucratie affecte les délais de traitement et on manque de plus en plus de travailleur·euse·s dans le secteur de la santé. Ces travailleur·euse·s sont donc victimes du système au même titre que les citoyen·ne·s qui ne reçoivent les soins auxquels ielles ont droit. Si on veut remédier à la pénurie de main-d’œuvre, il faudrait d’abord lutter contre le racisme systémique envers les immigrants·e·s, promouvoir l’équité et l’égalité au travail, sans quoi, le nombre de départs risque de continuer de grimper au fils des prochaines années.
CRÉDIT PHOTO: Nenad Stojkovic – FLICKR
1. Institut national de santé publique du Québec INSPQ, « Données COVID-19 au Québec, » 13 juillet 2022, https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
2. Fédération de la santé et des services sociaux, propos recueillis par Shanned Morales le 13 juillet 2022
3. Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Favoriser le mieux-être, Guide d’implantation d’un programme de qualité de vie au travail, Québec : ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, gouvernement du Québec, 2022,
4. CIUSSS de l’Estrie, propos recueillis par Shanned Morales le 14 juillet 2022
5. CIUSSS de l’Estrie, programme d’accueil organisationnel, Guide de référence pour les nouveaux employés, https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Carrieres/Nouveaux-emp…
6. Statistique Canada, Les expériences vécues par les travailleurs de la santé pendant la pandémie de COVID-19, septembre à novembre 2021, Ottawa : statistique Canada, 3 juin 2022, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220603/dq220603a-fra.htm
7. Pascale Prud’homme, Marc-Antoine Busque, Patrice Duguay, Daniel Côté, Travailleurs immigrants SST au Québec, État de connaissances statistiques et recension de sources de données,https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100841/n/tr…
8. WC-CTI Centre de travailleurs et travailleuses immigrants, « Un statut pour tous et toutes… EN FIN », communiqué, 8 juillet 2022. https://iwc-cti.ca/fr/nouvelles/communiques-de-presse/
9. Dubois, Hélène, « Les enjeux de la reconnaissance professionnelle au Québec », Recherches sociographiques, vol. 60, no 2, 2019 : https://doi.org/10.7202/1070972ar
10.