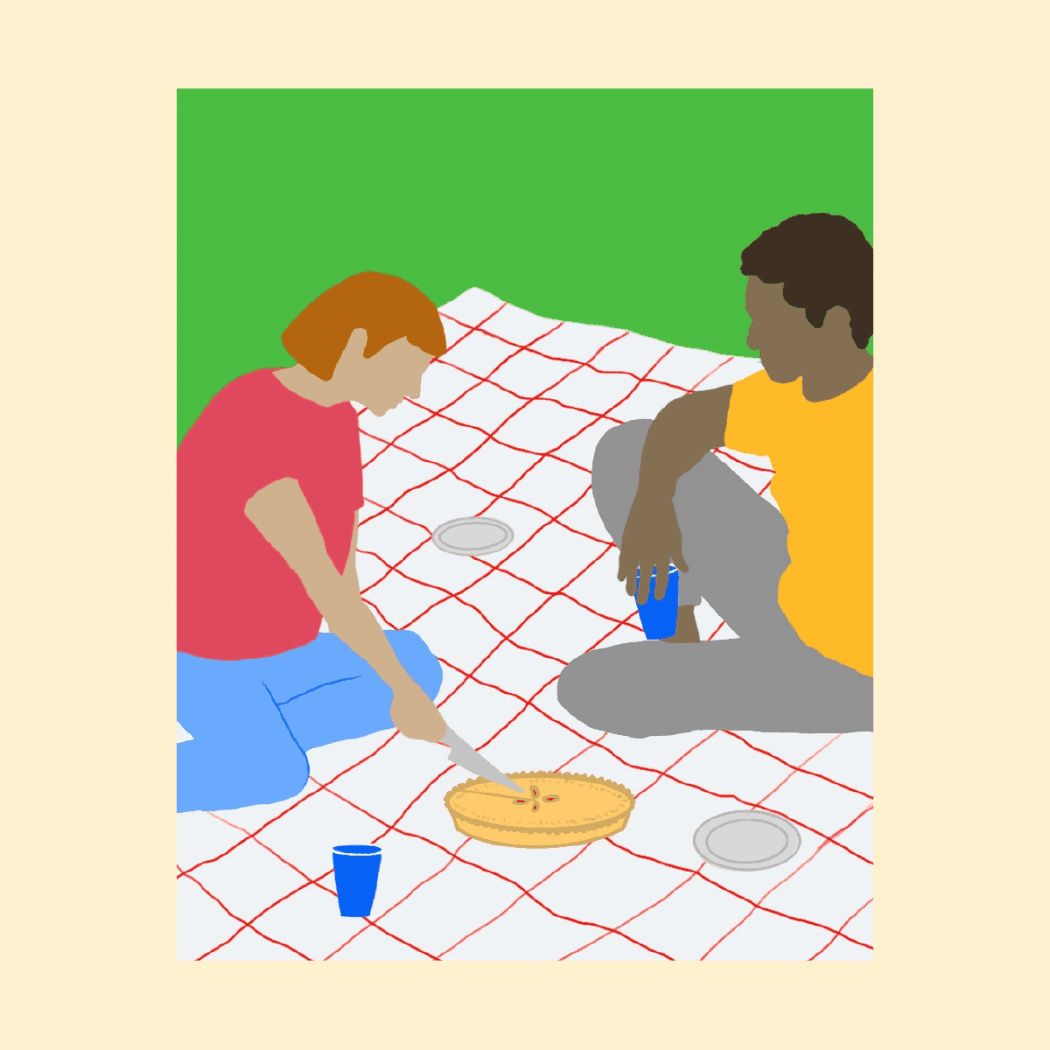par Jules Pector-Lallemand | Nov 15, 2022 | Feuilletons, Societé
Ce texte est extrait du cinquième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Siggi s’intéresse au parcours biographique des sociologues et s’interroge sur la place qu’il occupe dans leurs enquêtes. Pour ce cinquième numéro, nous avons rencontré Marcelo Otero, professeur et ancien directeur du Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses travaux portent sur le malheur ordinaire et la folie.
Siggi : Merci de me recevoir à votre bureau. Avant de commencer l’entretien, j’aimerais savoir comment il faut vous présenter. Est-ce que « sociologue des psychopathologies » vous convient?
Marcelo Otero (MO) : Je préfère « sociologue des problèmes sociaux complexes ». La folie ne se réduit pas aux maladies mentales, au cerveau, à l’esprit dérangé. La folie implique la société. Il n’y a pas de fous ou de folles en tant que tels, seulement une situation d’interaction particulière traversée par toutes sortes de tensions : l’esprit y joue un rôle important, mais il n’est pas seul. Si l’on veut comprendre ce qu’on appelle les psychopathologies, il faut explorer leur épaisseur sociale.
Siggi : Entendu! Puisqu’il s’agit d’un entretien biographique, il faut remonter un peu dans le temps. Commençons par une question toute simple : qu’est-ce qui a mené le jeune Marcelo vers la sociologie?
MO : J’ai grandi en Argentine, à Buenos Aires, sous la dictature militaire. Quand je suis entré à l’université dans la seconde moitié des années 1970, les départements de sociologie avaient été fermés par le régime parce qu’il s’agissait d’un repaire à marxistes. J’ai donc fait une première formation en ingénierie électrique. Puis, j’ai commencé une seconde formation à la Faculté de philosophie. Hélas, il y avait beaucoup de livres et d’auteurs interdits. Il n’était permis de lire que des philosophes chrétiens ou de droite. Tranquillement, je me suis dirigé vers l’histoire, parce que c’était une discipline qui était moins contrôlée. On pouvait étudier les historiens britanniques de la classe ouvrière, comme Edward Thompson et Christopher Hill.
Siggi : Comment ça se fait?
MO : Simplement parce que les militaires au pouvoir ne savaient pas que c’étaient des marxistes! (Rires.) Quand le régime est tombé en 1983, les départements de sociologie ont rouvert. C’était une période d’ébullition. J’ai terminé ma formation en philosophie, histoire et sociologie. J’ai commencé à enseigner et j’ai pu entamer des recherches sur ce qui m’intéressait vraiment : le croisement entre la pauvreté et la folie.
J’avais deux chantiers parallèles. Le premier était celui des asiles, où j’ai travaillé comme bénévole. Ça n’avait rien à voir avec les hôpitaux psychiatriques qu’on retrouve au Canada aujourd’hui. C’étaient de vieux bâtiments du XIXe siècle et, pour s’y rendre, il fallait habituellement traverser un immense parc. Quand on franchissait les portes de l’enceinte pour rejoindre la bâtisse, tout le monde nous suivait, comme une meute. C’était une expérience très impressionnante. Avec des collègues, on avait commencé à y recueillir des histoires de vie. On voyait comment le mental pathologique et le social problématique sont noués. On nous racontait des vies extrêmement difficiles, où la pauvreté, les problèmes familiaux et les maladies mentales étaient tellement tissés serrés que ça n’avait aucun sens de tenter de les séparer.
Le deuxième chantier était celui des bidonvilles. On y allait pour rencontrer des gens et on les écoutait nous raconter leur histoire. On découvrait que les habitants et habitantes avaient parfois de graves problèmes de santé mentale, mais par dégradation, déclassement et exclusion. La principale leçon que j’ai tirée de ces enquêtes est que la sociologie ne peut pas séparer le psychisme du social. Il était cependant très difficile d’aborder les deux en même temps. D’un côté, la psychanalyse était dominante en Argentine à l’époque. C’est une discipline qui exige une clientèle typée, de classe moyenne ou petite-bourgeoise. Ses concepts se prêtent mal à la compréhension de la grande pauvreté et ses effets sur le psychisme. De l’autre côté, les sociologues des inégalités ont tendance à étudier les stratifications sociales, les classes et les discriminations en laissant complètement de côté le psychisme.
Siggi : Pourquoi la psychanalyse s’adresse-t-elle plus spécifiquement aux classes aisées?
MO : Freud l’a conçue dans un contexte particulier : patriarcal, hiérarchique, sexiste. Il faut un contexte inspiré du modèle de la famille bourgeoise classique pour pouvoir analyser les symptômes d’une névrose. Quand le tissu social est désagrégé, ou plutôt agrégé autrement, comme dans un bidonville, on n’a pas du tout le même cadre. Et puis l’analyse est un échange dense entre deux personnes qui ont un capital culturel commun. Bref, c’est une thérapie qui a été conçue dans la petite bourgeoisie, pour la petite bourgeoisie. Il y a une phrase de Freud qui est désolante, mais qui résume bien cela : « Le barbare n’a pas de peine à bien se porter, tandis que pour le civilisé, c’est là une lourde tâche. » Autrement dit, celui ou celle qui travaille dans une usine ou vit dans un bidonville n’a pas un psychisme digne d’être analysé. La psychanalyse est une thérapie de classe. En plus, il faut payer et ça dure des années. Je ne dis pas ça pour critiquer les gens qui font une analyse. On trouve le sens à sa vie comme on peut, que ce soit dans une religion ou une analyse. Le problème, c’est quand une telle discipline, qui se prétend subversive, se retrouve dominante dans les hôpitaux et les universités. La psychanalyse – tout comme la psychiatrie d’ailleurs – a cette fâcheuse tendance à réduire des problèmes complexes à la seule intériorité et à délester tout le reste. D’où une « sociologie des problèmes sociaux complexes », qui tente de faire l’inverse, c’est-à-dire de se plonger dans la complexe texture du réel en conservant la tension entre le social et le psychisme.
Siggi : Est-ce que l’on consultait un ou une analyste dans votre famille? J’ai entendu dire que c’est très commun à Buenos Aires.
MO : Je viens d’une famille de classe moyenne inférieure, personne n’avait fait d’analyse. J’en ai fait une brièvement lorsque j’étais aux études. Je voulais comprendre ce monde qui me fascinait, mais j’avais beaucoup de réticences.
Cela dit, vous avez tout à fait raison. Quand j’y habitais encore, Buenos Aires était la ville de la psychanalyse. À l’université par exemple, tant en génie qu’en sociologie, je n’ai jamais connu quelqu’un qui n’avait pas de thérapeute. Il y a de nombreux cafés où les gens se donnaient rendez-vous uniquement pour discuter de leur thérapie. Le plus connu est le café La Paz, avec une énorme terrasse au coin de deux grandes artères, et si on tendait l’oreille, on pouvait entendre « j’ai un blocage… » ou « le contre-transfert m’inquiète… ». Ça peut paraître surréaliste, mais c’était très courant. Encore aujourd’hui, si je prends le taxi pour aller à l’aéroport et que je glisse l’expression « complexe d’Œdipe », mon chauffeur va savoir de quoi il s’agit et va me relancer sur ses propres « refoulements ». Il y a une diffusion énorme de la culture psychanalytique au cinéma, dans la littérature, mais surtout au théâtre. Le théâtre argentin met souvent en scène des enjeux œdipiens classiques. Même dans les kiosques de journaux, à côté de la presse à grand tirage, on retrouvait des livres de Freud ou de Lacan.
Siggi : Comment êtes-vous atterri à Montréal dans les années 1990?
MO : C’est un concours de circonstances. Je voulais m’établir quelque part en Amérique du Nord. J’avais un ami qui habitait à Montréal et j’ai vu passer un projet de recherche sur « les orphelins de Duplessis » qui rejoignait mes préoccupations.
Siggi : Qu’est-ce que ce thème veut dire?
MO : Jusqu’à la fin du régime de Maurice Duplessis, les asiles au Québec concentraient un ensemble d’individus dont personne ne voulait, dont on supposait la dangerosité ou dont on avait honte : pauvres, vagabond·e·s, handicapé·e·s, épileptiques, « filles-mères » (on dirait aujourd’hui « jeunes femmes monoparentales »), orphelin·e·s et, bien entendu, certaines personnes qui avaient perdu le contact avec la réalité. Ce type d’institution est intéressant parce qu’il nous indique ce qui ne fonctionne pas dans une société. Des personnes internées, ce sont des personnes que l’on ne veut pas voir, qui n’arrivent pas à fonctionner socialement selon les standards requis et qui sont perçues comme dérangeantes. Dans cet univers-là, il y a certes un petit noyau de gens qui délirent ou hallucinent, bref, qui incarnent le stéréotype du fou ou de la folle. Toutefois, la grande majorité des interné·e·s est plutôt faite d’individus qui ont des problématiques hybrides et complexes. L’enquête sur les orphelins de Duplessis m’a conduit à démarrer de multiples recherches qui consistaient à se demander : qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui avec les gens qu’on enfermait par le passé? Où sont-ils? Que font-ils? Comment les traite-t-on? Ce sont ces mêmes questions qui ont continué de m’habiter jusqu’à la publication des Fous dans la cité[1].
Bref, de recherche en recherche, j’ai adoré la vie à Montréal et j’ai eu la chance de décrocher un poste de professeur à l’UQAM.
Siggi : Une fois installé au Québec, vous avez commencé à vous pencher sur l’influence de la psychologie dans le traitement des problèmes sociaux, n’est-ce pas?
MO : Oui. Les psychologues sont aujourd’hui autorisés de facto à intervenir sur tous les problèmes. Qu’on discute de racisme, de pauvreté, de tueries de masse, de sexualité ou de souffrance au travail, on aborde toutes ces questions en termes psychologiques. Pour leur part, les approches sociologiques battent en retraite, car elles ont du mal à faire de la place au psychisme dans leurs analyses. C’est pourtant essentiel de le faire si on veut rejoindre de manière efficace les préoccupations des gens qui se tournent vers le codage massif de tout problème avec le lexique de la psychiatrie.
Siggi : C’est une des choses les plus intéressantes dans vos travaux : au lieu de prétendre que les gens se trompent et que leurs problèmes mentaux sont en réalité des problèmes découlant de conflits sociaux, vous parvenez à prendre au sérieux la souffrance psychique réelle des individus.
MO : Ironiquement, il y a un fort mépris de classe derrière les approches sociologiques qui refusent de voir chez les gens moins favorisés de véritables problèmes mentaux. Je m’explique. Bourdieu disait par exemple que « le pauvre souffre de sa condition ». Ce n’est vrai qu’en partie. Quand on dit à quelqu’un que sa position sociale surdétermine tous ses problèmes psychologiques, on est en train de dire : « Tu n’es que pauvre. » Pourtant, on n’est jamais que pauvre, que dominé·e, que discriminé·e. On est aussi un individu singulier. Tout le monde possède une singularité, peu importe sa condition sociale. On ne peut plus réduire le psychisme, l’identité ou la trajectoire personnelle à une dynamique de position de classe. Caetano Veloso, le célèbre poète et chansonnier brésilien, dit que « de près, personne n’est normal ». À y regarder de près, nous sommes tous et toutes des individus très complexes, avec une agentivité qui nous est propre. On doit donc se demander comment capter sociologiquement cette singularité sans la psychologiser. La souffrance est à la fois professionnelle, raciale, sexuelle, mais aussi psychique, individuelle et singulière. Il faut apprendre à l’explorer de manière un peu moins idéologique. Si on ne comprend pas ça, on écrase une dimension essentielle de l’individualité contemporaine. On s’empêche alors de comprendre des pans entiers des expériences significatives dans nos sociétés et on est moins entendu·e·s en tant que sociologues. À tort, la psychologie apparaît plus pertinente que la sociologie pour analyser bien des problèmes, justement parce qu’elle reconnaît la souffrance singulière.
Siggi : Dans L’ombre portée[2], votre livre sur la dépression, vous écrivez que le droit de souffrir est aujourd’hui une composante importante de l’individualité contemporaine. Qu’entendez-vous par là?
MO : Il y a deux choses. D’abord, on assiste à une extension inédite de la souffrance sociale. On peut se la représenter facilement avec les listes d’attentes pour consulter un·e thérapeute : elles débordent toujours malgré une importante croissance du nombre de psychologues diplômé·e·s qui n’arrivent pas, et n’arriveront jamais, à suffire à la demande. C’est parce qu’aujourd’hui, tout le monde souffre : les personnes âgées et les plus jeunes, les riches et les pauvres, les cols bleus et les cols blancs, les racisé·e·s et les pas racisé·e·s. Dans la première moitié du siècle dernier, c’étaient les membres de la petite bourgeoisie qui avaient le droit légitime de souffrir. Pour leur part, les cols bleus avaient certainement des problèmes musculosquelettiques, mais la plainte psychologique leur était étrangère et interdite. À titre d’exemple, au début des années 2000, un rapport sur les cols bleus à Montréal a été publié par un collègue. On y montrait que la moitié d’entre elles et eux disaient souffrir d’anxiété, de dépression ou de stress. Dans les années 1950, cela aurait été impossible. C’est la même chose dans l’armée : le nombre de suicides y augmente constamment. Pensez à Roméo Dallaire, haut commandant des armées canadiennes, qui exprime publiquement sa souffrance psychologique en 2000. Je dis toujours à la blague : « Imaginez Napoléon Bonaparte qui témoigne ouvertement de son mal-être : c’est impensable. »
On voit donc que la configuration de l’individualité s’est complètement transformée. L’anxiété et la dépression ont remplacé la névrose comme figure typique de la nervosité sociale, car les injonctions à la performance se sont substituées à la répression sociétale comme horizon de nos expériences. En caricaturant un peu, on peut dire que rien ne semble aujourd’hui interdit ni décidé d’avance, mais rien ne semble désormais possible ni certain. Dans un tel monde, comment ne pas être collectivement anxiodépressif·ve? Conséquemment, la souffrance psychologique s’est démocratisée.
Siggi : C’est une bien curieuse démocratisation.
MO : Absolument! Et elle est très révélatrice de ce second aspect dont je voulais vous parler : la souffrance ne s’est pas seulement étendue, son sens s’est également transformé. On ne souffre pas seul·e dans son coin, on veut que cette souffrance soit reconnue et validée par autrui. La souffrance, on peut la montrer, la mettre en forme et même la faire valoir politiquement. Le statut de la victime a complètement changé en 30 ans. Afficher publiquement que l’on est victime est une manière de dire : « J’existe, j’agis dans le monde et je demande réparation. » Grâce à l’avancée de la souffrance, on peut devenir un acteur ou une actrice dans un champ de revendications politiques.
Siggi : Est-ce qu’on souffre plus qu’avant ou cette souffrance a toujours existé, mais ne pouvait pas s’exprimer?
MO : C’est compliqué. Les sociologues ne s’entendent pas toujours sur cette question.
Si vous avez mal aux dents au Moyen Âge, vous vivez avec et vous vous y habituez. Chaque société a des repères culturels définissant les seuils de tolérance à la douleur. Depuis quelques décennies, il y a un nouvel espace social pour accueillir et exprimer la souffrance psychologique. Votre médecin vous demande « comment allez-vous? » plutôt que « où avez-vous mal? » Pour leur part, les psychologues sont partout dans les médias pour nous enjoindre à faire une introspection et à parler de nos émotions. À l’école primaire, si on fait un entretien avec un enfant à la maternelle, il sait ce qu’est l’anxiété, le stress et l’hyperactivité. Bref, on a une grille de lecture omniprésente qui nous amène à scruter notre intériorité et à coder des tensions de la vie quotidienne en termes psychologiques.
Siggi : Dans votre dernier livre, sur Michel Foucault[3], vous consacrez un chapitre à la sexualité afin de montrer que, contrairement à l’idée communément admise, il ne s’agit pas d’un domaine réprimé à partir du XIXe siècle; au contraire, elle y est mise en discours comme jamais. N’y a-t-il pas aussi une « hypothèse répressive » concernant la santé mentale, comme s’il s’agissait d’un sujet tabou et qu’en parler publiquement relevait d’un acte de subversion?
MO : Tout à fait. La souffrance appartient de moins en moins à l’intimité et de plus en plus à l’extimité. On ne cesse de parler de ses problèmes personnels, supposément privés, sur la place publique. On ne peut donc plus parler de répression de la parole, c’est même le contraire : il y a presque une injonction à se raconter. Parfois, il peut même y avoir un charme à dire « je suis hyperactif » ou, de manière métaphorique, « je suis un peu autiste ». Dans les films, on retrouve par exemple des détectives Asperger très performants et hyper intelligents, ce qui contribue à créer ce charme. C’est un réel enjeu, car à côté se trouve le drame des personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale réellement handicapants, les empêchant de vivre en société de manière satisfaisante. Ces gens, qui ont des vies très difficiles, peuvent parfois avoir du mal à accéder à de l’aide, précisément parce que tout le monde souffre et que les ressources d’aide psychologique sont constamment débordées.
Si je peux me permettre de soumettre une hypothèse politique, je dirais qu’un bon nombre de problèmes que nous avons ne se règlent pas en allant voir des médecins, des psychologues ou des psychiatres. L’accès élargi à la psychothérapie ne réglera pas nos problèmes les plus importants, tout comme l’augmentation de la consommation d’antidépresseurs ne diminue pas la prévalence sociale de la dépression.
Si on regarde les écoles primaires et secondaires, par exemple, ça n’a aucun sens qu’elles fonctionnent comme des usines du XIXe siècle, avec 30 élèves dans une même classe et où tout le monde suit le même parcours. Nous ne sommes plus à l’époque du fordisme social, nous vivons dans des sociétés singularistes qui produisent de la diversité. Pourquoi le nombre d’enfants hyperactifs ne cesse de croître dans nos écoles? C’est probablement parce qu’il faut repenser le système scolaire dans son ensemble. Si l’on regarde du côté des enjeux de genre et de sexualité, on pourrait aussi dire que l’école a conservé son modèle hétéronormatif alors que l’expression du genre s’est grandement diversifiée. Si une jeune personne trans est dépressive parce que des choses simples comme s’habiller ou aller aux toilettes binaires est une épreuve douloureuse, elle peut aller consulter un·e psy, mais ça ne réglera nullement le problème. Son cadre lui renverra constamment des raisons pour entretenir sa souffrance. Alors que si l’on met en place des dispositifs pour accueillir la singularisation croissante, comme des toilettes ou des uniformes non genrés, on pourra diminuer la prévalence de cette souffrance spécifique. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Le psychisme, le cerveau et la souffrance existent, ce ne sont pas des constructions idéologiques. Toutefois, il faut les comprendre en fonction des tensions sociales qui traversent la personne. Les conditions d’existence et la souffrance psychique sont deux réalités qui se font face. On ne peut pas affirmer que l’une est vraie et que l’autre est fausse.
Siggi : Vous avez une petite citation de Lacan au-dessus de votre bureau. Pouvez-vous nous la lire? Ça ferait peut-être une belle conclusion.
MO : Oui. (Rires.) « Vous pouvez savoir ce que vous avez dit, mais jamais ce que l’autre a entendu ». C’est le mur du langage. Je ne suis pas du tout lacanien, mais il y a de petites choses comme ça qui demeurent intéressantes et provocantes. La préoccupation pour le psychisme est un héritage que les sociologues argentin·e·s portent d’une manière ou d’une autre.
ILLUSTRATION : Alice Gaboury-Moreau
[1] Marcelo Otero, Les fous dans la cité : sociologie de la folie contemporaine, Montréal, Les éditions du Boréal, 2015.
[2] Marcelo Otero, L’ombre portée : l’individualité à l’épreuve de la dépression, Montréal, Les éditions du Boréal, 2012.
[3] Marcelo Otero, Foucault sociologue : critique de la raison impure, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, 2021.

par Jules Pector-Lallemand | Avr 11, 2022 | Feuilletons, Québec, Societé
Notice biographique : L’auteur travaillait auparavant dans les bars et les restaurants. Il n’a jamais vraiment quitté ce milieu, car il a passé les deux dernières années à l’étudier d’un point de vue sociologique. Accompagné de son collègue et ami photographe, il est allé faire un tour dans le bar qui l’employait jadis.
Ce texte est extrait du quatrième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Lorsque je fais de nouvelles rencontres, mon enquête sur la restauration est généralement un sujet de prédilection pour délier les langues et alimenter la conversation[1]. Nombreuses sont les personnes qui ont travaillé dans le domaine et qui en ont conservé quelques anecdotes mémorables. Ces séances de small talk se terminent systématiquement par une remarque soulignant l’exceptionnalité de ce milieu de travail : « C’est un monde à part », conclut-on.
C’est précisément cette impression, vague mais généralisée, que j’ai tenté de saisir en m’entretenant avec une quinzaine de serveurs et serveuses des restaurants et bars branchés du grand Montréal. Au fil de l’enquête, j’en suis venu à considérer la restauration comme un univers culturel qui marque durablement les individus qui y entrent. Voici quelques éléments de cette « culture ».
***
La transformation des goûts
Les personnes que j’ai rencontrées identifient clairement leur premier emploi dans le milieu comme une étape marquante : c’est à partir de ce moment qu’elles ont commencé à s’engager dans un travail permanent d’élargissement de leur culture gastronomique. Au début, on s’intéresse aux vins, aux aliments rares et aux cocktails pour être un bon serveur ou une bonne serveuse. On cherche à se donner les moyens de décrire adéquatement le menu à la clientèle, de bien faire son travail. Peu à peu, cet intérêt professionnel devient une passion personnelle. On développe alors un amour profond et sincère pour les vins nature, les produits du terroir, les nouvelles cartes de la métropole ou la dégustation de bières de microbrasserie. Cette passion trouve sa forme concrète dans les nombreuses sorties au restaurant, généralement avec ses collègues lors des journées de congé. On prend ainsi plaisir à découvrir de « bons produits » entre comparses qui savent en « apprécier la qualité ».
La bière staff
En restauration, la coutume veut que le patron ou la patronne offre une consommation d’alcool à ses employé·e·s une fois le quart de travail terminé. On s’installe généralement au bar afin de siroter sa « bière staff » tout en discutant avec les collègues. Ce moment de sociabilité est considéré comme quelque chose de précieux. En effet, le labeur en restauration est intense et appelle à un moment de détente. L’essentiel du travail se déroule sous pression durant les périodes de rush. Les collègues doivent être particulièrement bien coordonné·e·s afin de parvenir à servir une clientèle nombreuse. Il n’est pas rare que les nerfs des employé·e·s soient mis à rude épreuve : de petites erreurs peuvent générer de sérieuses frustrations et mener les collègues à se rudoyer. C’est pourquoi la bière staff est si importante : elle permet de relaxer, de rigoler et de s’excuser si nécessaire.
Puisqu’un des effets de l’alcool est de donner envie de boire plus d’alcool, cette bière est souvent la première d’une longue série. S’ensuivent logiquement des soirées bien arrosées. Les personnes avec qui je me suis entretenu n’ont pas manqué de souligner que cette sociabilité après le quart de travail est « quasiment obligatoire ». Celles et ceux qui n’y participent pas sont vu·e·s d’un mauvais œil, on les considère comme des outsiders qui ne prennent pas à cœur l’esprit d’équipe.
La tournée de shooters
Lorsqu’on travaille dans un restaurant ou un bar et que l’on veut montrer son appréciation d’un·e comparse, l’offrande par excellence est le shooter d’alcool fort. Que ce soit après le quart de travail ou durant celui-ci, on ne le boit jamais seul·e (on risquerait alors d’être étiqueté·e comme alcoolique). On le commande plutôt en tournée et l’on partage les petits contenants. Il ne s’agit pas d’une simple consommation d’alcool, mais d’un véritable rituel ayant pour effet de lier les participant·e·s. En entrechoquant les minuscules verres avant d’avaler le doux poison qu’ils contiennent, puis en les cognant à répétition contre le comptoir une fois vidés, on souligne sa solidarité et son appartenance à un monde commun.
Si la plupart des personnes que j’ai interrogées durant mon enquête apprécient le rituel, quelques-un·e·s m’ont confié trouver l’exercice épuisant à la longue. C’est parce que l’on peut difficilement s’y soustraire. Comme n’importe quel cadeau, il est mal vu de refuser une tournée de shooters. Celui ou celle qui ne paie jamais de tournées risque pour sa part d’être rapidement identifié·e comme « radin·e » ou « cheap ». Symbole d’appréciation mutuelle, la tournée de shooters n’en reste pas moins une obligation sociale, c’est-à-dire implicite et diffuse.
***
La culture des employé·e·s de la restauration ne se limite évidemment pas à ces trois éléments, mais ceux-ci me semblent particulièrement importants, car ils ont un point commun : ils participent à un brouillage des frontières entre le professionnel et le privé, le sérieux et le plaisir. Le travail prend aisément des airs de fête tandis que les temps libres sont marqués par les habitudes et les rituels issus de l’univers de la restauration. Si celui-ci se présente comme un « monde à part », c’est probablement parce qu’il offre plus qu’un mode de subsistance; il attire les personnes qui y travaillent dans un style de vie. Ce style de vie est caractérisé par de nombreuses sorties gourmandes et une sociabilité alcoolisée entre pairs.
On se délecte du style de vie de la restauration dans la vingtaine, mais lorsqu’on avance dans la trentaine ou la quarantaine, celui-ci devient de plus en plus incompatible avec ses autres engagements, familiaux notamment. Les personnes les plus vieilles que j’ai rencontrées semblaient souffrir d’un dilemme. Elles exprimaient un désir de « moins sortir », voire de quitter la restauration, mais faisaient état d’une incapacité à y parvenir. En réalité, c’est qu’elles sont rattachées à la restauration par des fils invisibles : leur communauté et leur identité sociale résident dans ce style de vie, y renoncer reviendrait à renoncer à une partie de soi.
J’ai employé le verbe « souffrir » plus haut, mais en y pensant bien, je ne crois pas que ce soit le mot approprié. Il est trop fort, il renvoie à quelque chose de pathétique. Ici, il n’y a rien de misérable, simplement un tiraillement intérieur, une difficulté d’être, une ambivalence existentielle qui relève davantage du soupir que des larmes.
[1] Celle-ci a abouti à la publication d’un livre qui vient tout juste de paraître : Pourboire : une sociologie de la restauration, Montréal, Les éditions XYZ, 2022.
CRÉDIT PHOTO : Alexandre Legault

par Jules Pector-Lallemand | Oct 24, 2021 | Feuilletons, Societé
Ce texte est extrait du troisième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Siggi s’intéresse au parcours biographique des sociologues et s’interroge sur la place que celui-ci occupe dans leurs recherches. Pour ce troisième numéro, nous avons rencontré Muriel Darmon, présidente de l’Association française de sociologie. S’intéressant notamment au champ médical, elle a acquis une notoriété grâce à son étude sociologique de l’anorexie. Elle publie cette année son nouveau livre sur les récupérations post-AVC.
Siggi : Ça vous dérange si on enregistre la discussion?
Muriel Darmon (MD) : Quand on est sociologue, avec le nombre d’entretiens qu’on mène, c’est difficile de dire : « Non, il n’y aura pas d’enregistrement. Allez vous faire cuire un œuf. Vous prendrez des notes à la main! » (Rires.)
Siggi : Super! On pourrait commencer par votre premier livre, Devenir anorexique[1], qui est tiré de votre thèse de doctorat. Pourquoi avoir choisi ce sujet?
MD : Je ne l’ai pas choisi pour des raisons biographiques. Je n’ai pas été anorexique ou boulimique et je n’en ai pas connu. En fait, à l’époque, c’était le sujet de l’heure. Au début des années 1990, il y avait une visibilité forte de l’anorexie. On disait que c’était la « maladie du siècle » ou la « maladie des campus américains ». Il y avait beaucoup d’articles sur ce sujet dans des magazines féminins. En les lisant, j’étais consternée. On n’évoquait que le lien avec la mère pour expliquer ce phénomène et à peine la société d’aujourd’hui et le corps des femmes. Il me semblait pourtant évident que les pratiques alimentaires ne sont pas neutres socialement, mais ça, personne ne le disait. J’avais donc une volonté d’aller observer de plus près l’anorexie et de mettre à l’épreuve cette impression que j’avais, soit celle que ma discipline pouvait nous permettre de voir ce qu’on ne voyait pas à l’époque.
Siggi : Qu’est-ce que vous avez réussi à faire voir?
MD : Je pense être parvenue à montrer que l’on n’est pas anorexique. Ce n’est pas un état. Il y a une « carrière » : c’est en fait un cheminement, un parcours avec des personnes marquantes, des phases et une progression. C’est une progression qui est de plus en plus extrême. Et puis, ce parcours n’est pas neutre en matière de propriétés sociales, ça n’arrive pas à tout le monde. Les anorexiques sont surtout de jeunes femmes des classes moyennes et supérieures. Ces propriétés — le genre, l’âge, l’origine sociale — sont ce qui rend possible la « carrière » d’anorexique.
Siggi : Comment les psychologues et les psychiatres ont reçu votre enquête?
MD : À l’époque, j’étais terrorisée à l’idée de leur présenter les résultats de ma recherche, mais j’ai tout de même envoyé le livre dans les services hospitaliers dans lesquels j’ai mené ma recherche. Ils ont été bien reçus finalement. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a eu des réceptions différentes selon l’approche des spécialistes à qui je présentais mon travail. Les psychiatres comportementaux et biologistes, qui sont contre la psychanalyse, ont apprécié la « carrière » anorexique. C’était une description des symptômes plus précise que celle qu’elles et ils avaient. Les psychologues comportementaux adhèrent aisément aux analyses interactionnistes de mon enquête, celles qui rendent compte des conduites des gens et des représentations qui les poussent à persister dans des pratiques anorexiques. Ces mêmes spécialistes étaient beaucoup plus critiques de la seconde partie du livre, qui se penche sur la culture familiale. C’est parce qu’elles et ils s’opposent à l’approche psychanalytique, qui s’intéresse non pas aux symptômes, mais au passé et aux relations avec les parents.
Comme vous vous en doutez, c’était l’inverse pour les psychiatres psychanalytiques. Elles et ils me disaient que j’étais aveuglée par les symptômes, que je ne voyais que ce que les patientes voulaient bien me laisser voir. En revanche, la partie sur l’inconscient social, qui en est un de genre et de classe, ça leur permettait de critiquer leurs collègues comportementaux.
Siggi : C’est fascinant de constater comment les spécialistes de l’anorexie ne prennent que ce qui confirme leur approche.
MD : Je ne peux pas leur reprocher. Même nous, les sociologues, nous le faisons! (Rires.)
Siggi : Votre livre a par la suite été traduit en anglais. Comment a-t-on réagi, dans le monde anglo-saxon, à cette étude?
MD : Quand je me suis lancée dans cette recherche, mes profs en France m’ont dit : « Tu es complètement folle! Qu’est-ce que c’est que cette idée? L’anorexie, c’est une question psychologique. D’accord, il y a Le suicide de Durkheim, mais ton enquête ne porte pas sur le suicide et tu n’es pas Durkheim. » La réaction à mon sujet de thèse aux États-Unis, c’était plutôt : « Ah oui? Encore l’anorexie! Mais qu’est-ce que tu vas pouvoir dire qu’on n’a pas déjà dit? » Il y avait plein de bouquins qui avaient été publiés sur le sujet, mais ils portaient uniquement sur le genre, pas sur la classe sociale. Il y a donc eu un intérêt pour Devenir anorexique.
Siggi : Vous êtes par la suite devenue chercheuse au Centre national de la recherche scientifique avant d’être élue à deux reprises comme présidente de l’Association française de sociologie.
MD : Oui, c’est une grande fierté de pouvoir représenter la discipline. Pour me faire élire, mon slogan était : « Il faut prendre la sociologie davantage au sérieux et se prendre soi-même moins au sérieux. » Ce n’est pas l’ensemble de mes collègues qui ont apprécié, mais personne ne se présentait contre moi! (Rires.)
Siggi : Qu’est-ce que vous vouliez dire avec ce slogan?
MD : Quand je suis arrivée dans le monde professionnel des sociologues dans les années 2000, on avait encore les grands pontes de la génération précédente, des hommes surtout, qui occupaient l’espace avec exactement la combinaison contraire. Ils se prenaient très au sérieux; en plus on est en France, ça fait partie de l’habitus national masculin de se prendre au sérieux. (Rires.) En même temps, ils avaient une sorte de désinvolture par rapport à la discipline. C’étaient par exemple les professeurs qui m’avaient déconseillé d’étudier l’anorexie parce que c’est un sujet qui appartient soi-disant à la psychologie. C’est un peu ce genre d’expériences que j’avais en tête au moment de formuler ce slogan. J’avais rencontré des sociologues qui ne croyaient pas beaucoup à la sociologie, mais qui, en même temps, se prenaient au sérieux et se mettaient eux-mêmes de l’avant. Je me disais donc qu’avec l’arrivée de ma génération, on pourrait peut-être parvenir à inverser cette tendance.
Siggi : C’est un slogan qui va résonner avec la mission de Siggi! C’est un peu le même esprit qui anime notre magazine : faire une sociologie qui prend au sérieux la vie quotidienne et en même temps qui descend les sociologues de leur piédestal en les forçant à abandonner leur langage hermétique.
MD : Oui, c’est ce qui m’importe : faire descendre les sociologues de leur piédestal sans pour autant renoncer scientifiquement à la qualité de la discipline. Je prône une sociologie sérieuse, rigoureuse, mais qui vise le développement de notre discipline plutôt que la promotion de soi-même.
Siggi : En quoi consiste votre travail de présidente de l’Association française de sociologie?
MD : En France, la sociologie est discutée dans les médias et par les ministres, le plus souvent pour en dire du mal. Ça fait des mois qu’on entend que les sociologues sont des « islamo-gauchistes », que les intersectionnalistes sont en train de faire mourir la civilisation française et que nous sommes perverti·e·s par l’Amérique. Il y a aussi eu un premier ministre qui a dit que « la sociologie, c’est la culture de l’excuse » parce qu’elle donne des prétextes aux gens pour être des délinquant·e·s ou des terroristes. La sociologie ferait le lit du terrorisme parce qu’elle cherche à comprendre la déviance. Le ministre de l’Éducation a même affirmé que « la sociologie, c’est l’apprentissage du fatalisme ». À force de dire qu’il y a des inégalités à l’école, les sociologues allaient persuader les élèves qu’il y en a. Ce serait donc notre faute s’il y a des inégalités.
Avec mes collègues, on a donc eu à écrire un certain nombre de lettres d’opinion. On a par exemple expliqué que la sociologie, c’est l’inverse du fatalisme puisque l’on donne des armes pour contrer les inégalités. Bref, une grosse partie du travail de présidente, c’est d’écrire ce genre de textes, de défendre publiquement la discipline quand elle est attaquée. C’est un peu désespérant parfois. Heureusement, c’est un travail collectif, qui ne se fait pas seule.
Siggi : Vous venez tout juste de faire paraître Réparer les cerveaux[2], le résultat d’une étude sur la rééducation après les accidents vasculaires cérébraux (AVC). La première chose que nous nous sommes dite quand nous avons vu le thème, c’est : « Elle récidive et s’attaque à un autre objet de recherche qui appartient à la médecine. »
MD : Conquérir un objet d’étude inhabituel pour la sociologie, un objet qu’on penserait impossible à étudier du point de vue de notre discipline, c’est ce qui me motive. Il ne s’agit cependant pas de dire que je vais construire la théorie du cerveau qui va remplacer toutes les autres. Simplement, j’essaie de passer avec ma débroussailleuse et de faire mon chemin, qui n’est pas celui des autres, afin de montrer quelque chose que les gens dans le monde hospitalier ne voient pas, parce que ça ne les intéresse pas ou qu’ils n’ont pas les outils pour les penser. Quand je lis les neurologues sur la plasticité du cerveau, je me dis que ces cerveaux n’existent tout de même pas dans un vide social. Ce ne sont pas que des paquets d’influx nerveux dans une cuve au milieu de nulle part.
Siggi : Dans les premières pages de ce livre, vous abordez le thème de « l’interdisciplinarité ». C’est un concept à la mode, enveloppé de vertus. Pour obtenir une subvention, il est presque obligatoire de l’insérer dans sa demande. Vous émettez cependant un doute à son sujet. Quel peut être le problème avec l’interdisciplinarité?
MD : En soi, il n’y a pas de problème. Cependant, au moins dans le domaine des neurosciences, lorsque l’on invite des sociologues dans les recherches, on ne veut pas qu’elles et ils travaillent sur le même objet d’étude. On m’a déjà invitée à participer à une recherche en me disant : « On a besoin d’une dimension « science sociale » dans notre projet pour obtenir des subventions. » On voulait que je dise que l’étude est importante pour « la société » et que j’évalue la qualité des relations sociales dans le service hospitalier. Les patients et patientes, par contre, ce n’étaient pas mes affaires. Je leur ai dit que si je me joignais à ce projet, c’était en fait pour faire de la vraie interdisciplinarité, celle où l’on travaille de manière autonome sur le même objet.
Dans Réparer les cerveaux, c’est ce que j’ai fait. Je me suis intéressée directement aux tests cognitifs, par exemple. Là où des neuropsychologues voient un usage des fonctions exécutives diminué par l’AVC, je vois une situation où les évaluations hospitalières ont une forme scolaire. Cette forme va complètement empêcher un patient ou une patiente issu·e d’un milieu populaire de bien réussir le test et d’en profiter pour sa rééducation. À l’inverse, les personnes très diplômées ont un rapport au savoir plus congruent à la manière dont les tests et l’hôpital fonctionnent. Là, j’étudie exactement le même objet que les professionnel·le·s de la santé. Je ne conteste pas leurs connaissances, mais j’amène quelque chose de différent. Quand on me donne une telle autonomie, que l’on ne me force pas à renoncer à mon point de vue, on peut avoir un véritable dialogue interdisciplinaire. Il y a un problème avec l’interdisciplinarité quand la discipline dominante dicte quoi faire à la discipline dominée.
Siggi : Est-ce que cette étude vous a demandé d’apprendre une quantité importante de connaissances médicales?
MD : En partie seulement. Les ethnographes ne sont pas toutes et tous d’accord, mais je suis d’avis qu’il ne faut pas trop en savoir au sujet de son terrain d’enquête afin de pouvoir être surprise et ne pas tout trouver normal. C’est une chance de ne pas tout comprendre : on pose alors des questions et on se fait expliquer.
Il y a un moment de mon enquête où je suis avec un stagiaire et une médecin qui discutent. Il et elle ne savent pas si une incompétence visuelle d’un patient est liée à son AVC ou à une autre pathologie qu’il a. Je ne suis pas certaine de bien suivre la discussion. Je demande alors à la médecin : « Est-ce que vous pensez que le patient ne voit pas bien, mais qu’il cherche à vous tromper en affirmant bien voir, ou est-ce l’inverse? » La médecin me répond alors : « On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du patient. » Elle dit ça en plein milieu du bureau infirmier, entourée de cinquante imageries médicales du cerveau de ce même patient! Cette question que je pose parce que je ne comprends pas un mot de ce qu’il et elle sont en train de raconter me permet de comprendre une chose très importante : ces spécialistes de l’AVC, qui ont une compréhension poussée des mécanismes neurologiques, n’ont pas vraiment d’outils pour interpréter ce qui se passe dans la tête des patientes et des patients. Ce que les spécialistes font alors, c’est du jugement social. Si on a tendance à croire un patient pour des raisons interactionnelles, on dit qu’il est crédible et qu’il va bien lorsqu’il affirme que c’est le cas. Si on prend un autre patient, qui est un peu macho, viriliste et expansif, on le juge différemment. Les médecins femmes, qui ont à souffrir de cette imposition de masculinité hégémonique, mettent en doute ce qu’il dit. Je les entends parler : « Il dit qu’il va très bien, mais en fait c’est une désinhibition et un déni des troubles liés à l’AVC. » C’est effectivement une des conséquences possibles d’un AVC, mais on a beau avoir cinquante IRM (imagerie par résonance magnétique), on ne sait pas si c’est le cas ou non. Pour trancher, les spécialistes ont recours à des jugements sociaux. Je ne pense pas que je m’en serais rendu compte si je n’avais pas posé autant de questions en toute innocence.
Il faut m’arrêter : je suis en train de tout spoiler mon livre! D’ailleurs, vous n’avez pas un mot français au Québec pour spoiler?
Siggi : Oui, « divulgâcher », mais je vous déconseille de l’utiliser à l’oral, on se moquera de vous!
MD : Dommage, j’aime bien ce mot. En tout cas, il reste encore des surprises dans ce livre pour celles et ceux que le sujet intéresse.
CRÉDIT PHOTO: The Future of Radiology and Artificial Intelligence. The Medical Futurist (2017-06-29). (Creative commons)
1] Muriel Darmon, Devenir anorexique, une approche sociologique, Paris, La Découverte, 2003.
[2] Muriel Darmon, Réparer les cerveaux, sociologie des pertes et des récupérations post-AVC, Paris, La Découverte, 2021.

par Jules Pector-Lallemand | Mai 20, 2021 | Entrevues
Illustration d’Alice Gaboury-Moreau
Ce texte est extrait du deuxième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Siggi s’intéresse à la biographie des sociologues et s’interroge sur la place qu’elle occupe dans leurs recherches. Pour ce deuxième numéro, nous avons rencontré Christopher McAll, professeur à l’Université de Montréal et cofondateur du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS).
Christopher McAll (CM) : Avant de commencer, je dois vous prévenir : j’ai eu cette semaine le malheur de consulter sur le Web une plateforme académique de réseautage. J’y ai découvert une véritable mise en marché de soi, avec le nombre de citations par semaine et des statistiques de performance individuelle. Je suis un peu préoccupé par cette hyperindividualisation des carrières. Pour moi, les moments les plus intéressants en recherche consistent à faire partie d’un collectif, où tous et toutes ont un rôle complémentaire. Tout ça pour dire que j’ai quelques réticences à faire un entretien biographique…
Siggi : C’est entendu. Nous ferons de notre mieux pour que l’article ne tourne pas au culte de la personnalité! (Rires.)
***
Siggi : Vous avez mené de nombreuses recherches sur les inégalités sociales et les discriminations. On pourrait commencer par cette question très large : d’où vous vient cette préoccupation?
CM : C’est facile de construire un lien entre mon travail et mes expériences personnelles après les faits, mais essayons quand même : jeune, j’étais étonné par la société dans laquelle j’ai grandi, le sud de l’Angleterre des années 1950-1960. Je viens d’une ville balnéaire marquée par les inégalités. J’avais deux parents médecins et la santé publique en était à ses débuts. Mes parents pratiquaient la médecine de famille auprès de personnes de différentes origines sociales. Leur bureau était installé chez nous; la salle d’attente était d’ailleurs, pour nous, enfants, la salle de jeux. On vivait sur une rue qui marquait la frontière entre un quartier ouvrier et un quartier aisé, avec des touristes et des grands hôtels. C’était une société très divisée sur le plan des classes sociales. Je côtoyais des enfants qui fréquentaient l’école publique et d’autres qui fréquentaient l’école privée. Il y avait aussi des différences de dialecte selon l’origine de classe. Dès qu’on ouvrait la bouche, on était marqué socialement. Très tôt, j’ai compris qu’il y avait peu de justice sociale dans ce système-là.
Un peu plus vieux, quand je suis entré à l’Université d’Oxford en études littéraires, je me présentais dans des agences de placement pour gagner de l’argent pendant les vacances; je me retrouvais avec des immigrant∙e∙s et des gens à statut précaire. Le matin, on nous envoyait dans différentes usines. J’ai travaillé dans des cimenteries et des chaînes de montage. J’ai commencé à être confronté à ce que ça signifie le travail en usine. À l’université, on avait aussi un groupe de lecture sur Marx. Ces différentes expériences commençaient à s’assembler et changer ma perception de la société. Cela dit, je n’étais pas un étudiant particulièrement militant… Bon, j’ai dit que je ne voulais pas faire d’entretien biographique, mais me voilà en plein dedans! (Rires.)
Siggi : Tant qu’à y être, profitons-en! Vous disiez que vous n’étiez pas particulièrement militant…
CM : Oui, même si j’ai tout de même vécu mai 68. À Londres, ce n’étaient pas tout à fait des révoltes étudiantes, c’étaient plutôt des soulèvements contre la guerre du Vietnam. Il y avait de grandes manifestations et de la répression policière. Je suis devenu sensible à ces enjeux, mais je n’étais pas trop impliqué. J’étais plutôt pris par mes études sur le monde médiéval à ce moment.
Siggi : Qu’est-ce qui vous a amené à Montréal?
CM : Ma famille est, en partie, d’origine écossaise. J’ai été élevé de manière à m’identifier à tout ce qui est celtique. On nous amenait en voyage en Écosse. Cela m’a tellement marqué que j’ai fait mon doctorat sur le droit irlandais et gallois au Moyen Âge. J’allais donc souvent à Dublin ou en Écosse pour mes recherches, et c’est sur la route dans les Hébrides que j’ai rencontré une Québécoise par une journée de pluie. Nous sommes déménagés au Québec après mes études.
Siggi : Vous êtes ensuite passé du droit médiéval à la sociologie.
CM : J’ai continué mon parcours en anthropologie du droit à McGill, où j’ai enseigné dans les années 1980 sur le thème de la classe et de l’ethnicité. C’est grâce à ces enseignements que j’ai approfondi ma connaissance des ouvrages sociologiques fondamentaux, ce qui a abouti plus tard à la publication d’un livre[i]. Il s’agissait de faire la jonction entre les deux grandes traditions de la pensée sociale en faisant dialoguer Max Weber et Karl Marx. Je voulais montrer que les classes sociales sont traversées par des processus d’ethnicisation comme ce que j’avais vécu en Angleterre; il y a des dialectes de classe, des cultures de classe, un phénomène d’endogamie — se marier à l’intérieur de sa classe sociale — un sentiment d’appartenance, etc.
Or, le livre est paru en 1990, tout juste après la chute du mur de Berlin, et on ne voulait plus entendre parler des classes sociales ni de Marx! Si j’avais changé le titre du livre et des chapitres, ça aurait peut-être mieux passé.
Siggi : Dans les années 1990, vous avez mené des recherches en sociologie du langage, n’est-ce pas?
CM : Je venais d’obtenir un poste de professeur à l’Université de Montréal, depuis à peine une semaine, et on est venu frapper à ma porte. C’était le responsable du Secrétariat à la politique linguistique. Il cherchait quelqu’un pour travailler sur l’intégration linguistique des immigrant∙e∙s. Avec deux chercheuses, nous avons créé une petite unité de recherche en sociologie du langage. Nous avons commencé à découvrir des choses fascinantes à propos des personnes immigrées qui travaillaient dans des usines. Par exemple, nous avons constaté que, souvent, elles n’avaient même pas le droit de parler au travail! À l’époque, on disait : « Si les gens travaillent en français, ils vont s’intégrer à la société québécoise. » Or, dans le silence imposé et dans des fonctions où la lecture n’a pas sa place, « l’intégration linguistique » ne veut pas dire grand-chose.
Nous avons également constaté que, dans certains secteurs, les cadres favorisaient l’embauche de personnes qui parlaient des langues différentes pour qu’elles ne puissent pas communiquer entre elles. Cette situation créait un rapport de force à l’avantage des patron∙ne∙s. Malheureusement, j’ai éventuellement dû mettre de côté mes recherches en sociologie du langage au profit d’une autre recherche.
Siggi : De quoi était-il question dans cette recherche?
CM : Avec des collègues et conjointement avec le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), nous menions une étude sur l’aide sociale. Nous avons interrogé une centaine de parents avec des enfants à charge bénéficiant de l’aide sociale, mais aussi des agent∙e∙s gouvernementaux∙les. Nous avons constaté l’étendue des préjugés envers les bénéficiaires. Nous sommes ensuite allé∙e∙s sur la place publique avec nos partenaires pour sensibiliser le public à ces questions.
Siggi : Quelle forme de discrimination avez-vous identifiée?
CM : Je suis allé témoigner devant le Tribunal des droits de la personne. Dans la Charte québécoise, on énumère les critères de discrimination interdite. Il y a une liste, avec notamment le sexe, la race, l’origine ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle. Mais il y a aussi un dernier critère, plus vague, intitulé « condition sociale »; il signifie en fait « autres ». L’idée était de plaider que la catégorie stigmatisante de « BS » (pour bénéficiaire du « bien-être social ») était une « condition sociale » susceptible de donner lieu à la discrimination.
Le cas qui est allé devant le tribunal était celui d’une personne qui avait fait un stage dans un des ministères du Gouvernement du Québec. On lui avait fait faire des photocopies pendant six mois. Dès le premier jour, on l’avait posté devant la photocopieuse et lui avait dit : « Voici la machine. » Il n’a pas bougé de là. C’était censé être un stage pour développer son « employabilité ». Parce qu’il n’a rien appris, les avocat∙e∙s ont plaidé qu’il s’agissait en fait de cheap labor : on se servait de lui pour faire un travail qui était normalement accompli par un∙e employé∙e rémunéré∙e, avec des droits et des avantages sociaux.
J’ai donc été convoqué en tant que sociologue pour présenter les résultats de notre recherche. J’ai présenté notre étude, preuves à l’appui, et expliqué que dès que quelqu’un cherche un emploi et qu’il ou elle a l’étiquette « BS », il ou elle est traité∙e comme un sous-humain. Le tribunal a accepté l’argument! Dans le jugement, on parle même de la « preuve sociologique ». Après les audiences, le juge qui a présidé est venu me dire qu’il était bien dommage qu’on n’ait pas de sociologues plus souvent au tribunal, car c’est un peu comme si on avait cent témoins dans la salle.
Siggi : Un sociologue à la cour, c’est assez rare.
CM : Oui, et pourtant, il n’y a pas de raison de ne pas y être. Dans l’histoire du droit, ce sont généralement les témoignages convergents qui portent la preuve, pas les statistiques. Au tribunal, on essaie de rétablir des rapports sociaux : des personnes en chair et en os qui ont posé des gestes dans des lieux concrets. Quand on conduit des entretiens approfondis en sociologie, on est dans la pure tradition du droit : on est à la recherche de témoignages qui convergent afin d’expliquer un phénomène social.
Siggi : Pouvez-vous nous parler un peu de la création du CREMIS?
CM : En 2004, le CLSC Les Faubourgs au centre-ville de Montréal m’a approché pour que je sois directeur d’un nouveau centre de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale. C’était un rêve fou que j’avais dans les années 1990 de fonder un centre de recherche en plein cœur de Montréal, et là, ça devenait possible. Je leur ai dit que j’accepterais, à condition que la recherche porte plus largement sur les inégalités sociales, ainsi que sur la discrimination — le principal mécanisme de production des inégalités — et les pratiques alternatives de citoyenneté. Il ne faut pas se contenter de critiquer pour critiquer, sinon on n’est que la vieille gauche universitaire. Il faut se donner la possibilité d’imaginer d’autres façons de faire.
Siggi : Quand vous dites « imaginer d’autres façons de faire », est-ce que cela signifie que vous êtes d’avis que la sociologie a pour vocation d’être politiquement engagée?
CM : Ce n’est pas évident de répondre à une question comme ça. Je ferai un petit détour si vous le voulez bien.
J’aime beaucoup enseigner l’histoire de la pensée sociale, j’y retrouve notamment le monde médiéval. Dans mes cours, on lit par exemple les écrits de Christine de Pizan, du début du 15e siècle, qui critique la domination masculine : ça aurait pu être écrit avant-hier! Comme je dis à mes étudiant∙e∙s, il ne faut pas penser que nous sommes supérieur∙e∙s par rapport à tou∙te∙s celles et ceux qui nous ont précédé∙e∙s. Il y a du progrès technique, mais il n’y a aucune raison de croire qu’il y a du progrès humain. En ajoutant d’autres lectures d’époque, petit à petit, je remplis les trous d’un immense portrait historique. Quand je fais de la recherche pour ce cours, je ne suis pas « engagé », je suis simplement impliqué dans la découverte des racines de la société dans laquelle nous vivons.
Il y a aussi un autre volet à mon travail, non pas tourné vers le passé, mais plutôt vers l’avenir. Au CREMIS, nous constatons que de multiples réponses aux problèmes qui nous entourent sont déjà là. Il faut remettre en question l’idée selon laquelle la société est une immense structure qu’il est impossible de transformer. Les approches féministes ont bien démontré que les rapports hommes-femmes — et par extension les autres rapports sociaux inégalitaires — sont construits dans l’action du quotidien. La société se construit et se reconstruit au jour le jour. C’est en fait une vieille idée de Max Weber et de la sociologie allemande d’avant la Première Guerre qui a été perdue dans les brumes. Vu sous cet angle, non seulement est-il possible d’identifier des lieux d’interaction où les rapports inégalitaires se reproduisent, mais aussi des lieux où d’autres rapports se construisent sur des bases différentes.
Au CREMIS, qui œuvre maintenant au sein d’un CIUSSS, nous sommes entouré∙e∙s d’intervenant∙e∙s qui vont tous les jours au front. Il s’agit alors de poser la question suivante : est-ce que leurs interventions contribuent, malgré les bonnes intentions, au maintien de rapports sociaux stigmatisants ou, au contraire, à la création d’autres rapports, fondés sur l’égalité?
Prenons, par exemple, un projet de recherche sur le soutien à domicile des personnes âgées que nous avons réalisé au cours des dernières années. Les auxiliaires familiales — au féminin, puisqu’il s’agit majoritairement de femmes — se battent pour maintenir une approche humanisante auprès des personnes vieillissantes, c’est-à-dire de prendre le temps de discuter et de créer des liens de soutien, voire d’amitié. Le système de santé est très centralisé et toujours en train de réduire ces visites à de simples gestes, à faire des auxiliaires de simples exécutantes. Nous, comme sociologues, où nous situons-nous?
Au fondement de la sociologie, il y a un regard critique, mais on ne peut pas s’arrêter là. Il faut documenter ce qui se passe sur le terrain, puis faire connaître et mettre en valeur les pratiques alternatives, qui sont souvent localisées et peu reconnues. Les universitaires n’ont pas le monopole de la critique sociale et ce n’est pas de nous que viendront les alternatives. Cela dit, nous avons un rôle central à jouer en tant que citoyen∙ne∙s pour aider à les faire émerger.
[i] Christopher McAll, Class, Ethnicity and Social Inequality, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1990.
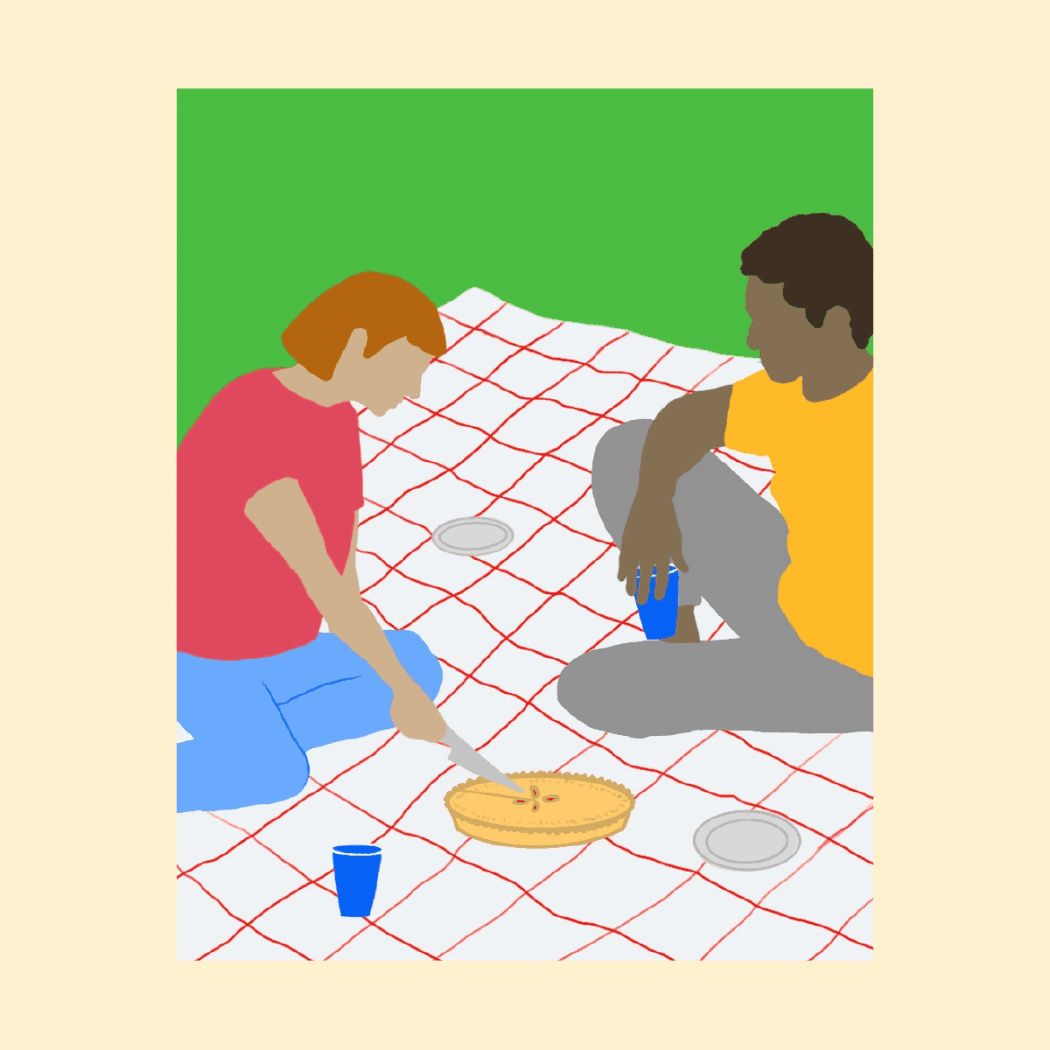
par Jules Pector-Lallemand | Avr 16, 2021 | Entrevues, Societé
Illustrations de Laurence Thibault
Ce texte est extrait du deuxième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Siggi : Dans vos recherches, vous vous êtes intéressée à la gestion de l’argent au sein des couples. Dans un de vos livres[1], vous mentionnez qu’il s’agit d’un sujet qui rend mal à l’aise les personnes que vous interrogez. Pourquoi est-ce si difficile de parler d’argent lorsque l’on est amoureux∙se?
Hélène Belleau (HB) : C’est un sujet tabou.
Avec mes collègues, j’ai mené au cours des dernières années une grande investigation : plus de 100 entretiens approfondis et une enquête statistique auprès de 3600 répondant∙e∙s de partout au Québec. Nous avons demandé à des individus en couple s’ils parlent d’argent et 40 % ont indiqué ne jamais en avoir parlé! Dans les entretiens, les gens disent : « On n’en a pas discuté, ça s’est organisé naturellement. » Si on lit un magazine féminin, on peut retrouver de nombreux articles sur la sexualité, mais rien sur la manière dont deux conjoint∙e∙s gèrent leur argent.
S’il y a un tel malaise à l’intérieur des couples, c’est parce que l’argent et l’amour fonctionnent selon deux logiques apparemment incompatibles. D’un côté, il y a la logique de l’argent, qui correspond au marché, aux intérêts personnels et aux choix rationnels. D’un autre côté, il y a la grammaire amoureuse qui induit des codes de conduite. Une règle importante consiste à faire passer l’autre et le couple avant ses intérêts personnels. On se montre généreux∙se avec l’autre, surtout au début de la relation. Dire à son conjoint ou sa conjointe : « Écoute, je ne trouve pas que la division des dépenses est équitable », c’est très difficile. On peut donner l’impression d’être égoïste et calculateur∙rice alors qu’en amour, c’est l’altruisme qu’on doit mettre à l’avant-plan.
Un autre aspect du code amoureux est la fiction de la durée, idée selon laquelle la relation durera toujours; la rupture n’est pas envisageable. Et même si l’on y pense, on se dit que la séparation se déroulera dans l’harmonie. Les relations d’aujourd’hui ne sont plus basées sur l’institution du mariage, mais sur la confiance.
La logique amoureuse est extrêmement importante. C’est le liant des familles; c’est la colle qui fait tenir le foyer. Contrairement à ce que l’on dit, l’amour ne rend pas aveugle : il y a des codes de conduite que tout le monde connaît et met en pratique. Mais ces codes constituent des obstacles aux discussions autour de l’argent et contribuent à entretenir certaines inégalités financières.
Siggi : Cette logique amoureuse est-elle explicitement connue?
HB : Un jour, j’ai fait une conférence où je présentais les codes de l’amour et, à la pause, il y a quelques personnes qui sont venues me voir pour me dire : « Hélène, c’est dur! » (rires), en voulant dire : « Tu révèles des choses sur lesquelles on garde habituellement un flou. » La logique amoureuse, on la connaît intimement. On demande à un enfant de six ans et il est capable de savoir comment on se comporte quand on est amoureux∙se. Mais on n’en a pas tout à fait conscience, elle reste en effet largement implicite.
Siggi : Même si la grammaire amoureuse fait en sorte que l’on parle peu de finances, il faut tout de même gérer l’argent selon certains principes. Quels sont les modes de gestion que l’on retrouve le plus fréquemment dans les couples au Québec?
HB : Il y a deux grandes logiques de gestion : le partage des dépenses et la mise en commun des revenus.
La première implique de faire une liste des dépenses jugées communes. Cependant, ce qui est en commun varie d’un couple à l’autre, et parfois même au sein du couple. Généralement, il y a le loyer, la nourriture, Hydro, etc. Après, les loisirs, l’informatique, la bière ou les pots de cosmétiques peuvent être inclus ou exclus. Souvent, la liste des choses mise en commun n’existe pas formellement, mais se constitue au jour le jour sans que l’on y réfléchisse nécessairement. C’est comme ça : on glisse dans la vie quotidienne, les choses y sont rarement formalisées. Bref, une fois que l’on a une liste plus ou moins implicite de ce qui est commun, on décide si l’on divise moitié-moitié ou au prorata du revenu.
L’autre façon de fonctionner est la mise en commun des revenus, qui correspond à l’idée du revenu familial. Ce système est à la base de toutes nos politiques sociales. Dans ce mode de gestion, les conjoint∙e∙s mettent tous les revenus ensemble et dépensent à partir de ce pot commun.
Siggi : Y a-t-il un décalage entre les principes guidant la gestion de l’argent et sa mise en pratique?
HB : Les gens nous disent souvent : « Tout est en commun. » Toutefois, lorsque l’on creuse un peu lors des entretiens, on apprend par exemple que le side line (le second emploi), n’est pas partagé. Parfois, c’est aussi le bonus qui est gardé pour soi.
L’autre élément que nous avons récemment découvert est que même quand tous les revenus sont mis en commun, l’épargne, elle, est gérée séparément. Statistiquement, même parmi les jeunes générations, les femmes réduisent leur temps de travail à l’arrivée des enfants alors que les hommes l’augmentent pour compenser. Petit à petit, les écarts de revenus se creusent. Les hommes ont une capacité plus grande à économiser. Les femmes, ayant réduit leur temps de travail, épargnent moins. Plus il y a d’enfants, plus l’écart se creuse. Une femme a en moyenne près de 40 % moins d’économies que son conjoint. Lors d’une rupture, cette situation devient un véritable problème.
Ce n’est pas trop mal quand les couples sont mariés, parce que le droit impose un partage des biens, de la maison familiale et aussi des fonds de retraite. Or, lors d’une rupture dans un ménage en union libre, chacun repart avec ce qu’il ou elle a payé. Beaucoup de femmes se retrouvent alors avec très peu d’épargnes, voire rien du tout. Et ce n’est pas anecdotique : le Québec est le leader mondial des unions libres! Nous vivons d’ailleurs dans la seule province canadienne sans encadrement juridique de ces unions.
Ce déséquilibre touchant l’épargne est rarement connu. Parfois, les conjoint∙e∙s le savent, mais la fiction de la durée et la confiance en l’autre font en sorte que l’on ne s’en soucie pas.
Siggi : Quel serait le mode de gestion de l’argent le plus juste dans un couple?
HB : Je ne pense pas qu’il existe un système parfait. Quand il y a de grands écarts de revenus au sein du couple, le partage des dépenses au prorata peut sembler le plus égalitaire; ainsi, il n’y a pas un∙e conjoint∙e qui essaye de contrôler l’argent de l’autre. Or, le problème est que le niveau de vie du couple est à la hauteur du revenu le plus important. Alors, la personne qui gagne moins vit nettement au-dessus de ses moyens. Elle va avoir un logement plus grand, des vacances plus dispendieuses et de la nourriture plus chère que ce qu’elle pourrait se permettre avec quelqu’un qui a le même revenu. Cette personne — qui est généralement une femme — ne parviendra pas à épargner et devra même piger dans ses économies pour pouvoir suivre ce rythme de vie.
Siggi : La mise en commun des revenus serait-elle la solution pour éviter ce problème?
HB : Ça peut être une solution, à condition de mettre en commun l’épargne. Dans certains couples, ce modèle ne fonctionne cependant pas. L’un∙e est plus anxieux∙se que l’autre en matière de finances. Il se développe alors toutes sortes de stratégies pour empêcher l’autre de dépenser. Un principe important en sociologie de l’économie est que l’on n’oublie jamais d’où vient l’argent. Dans un couple, lorsqu’une personne a un plus grand revenu, celle-ci a plus de légitimité à prendre des décisions liées aux dépenses. On s’en rend compte non pas dans des chicanes ou des négociations, mais plutôt à travers de petites remarques au quotidien. Prenons un exemple : madame revient de magasiner, son chum est dans le salon et dit : « Ah, tu es encore allée magasiner? » Ça paraît anodin, mais cette remarque est en quelque sorte un rappel que l’argent est plus à lui qu’à elle. Se développent en retour des tactiques pour cacher des dépenses, comme enlever l’étiquette d’un vêtement récemment acheté et dire : « C’est ma mère qui me l’a donné. » Il s’agit d’un exemple, mais nos enquêté∙e∙s nous confient toutes sortes de moyens de cacher des dépenses; c’est généralement fait sans malveillance, simplement pour éviter des frictions avec son amoureux∙se.
Siggi : L’argent est-il une grande source de friction dans les couples?
HB : On dit souvent que l’argent est la principale cause de divorce; je ne suis pas d’accord. Je pense qu’au moment d’une séparation l’argent permet plutôt d’exprimer toutes les frustrations et les différences de valeurs. Quelle importance accorde-t-on à la nourriture? Pour certain∙e∙s, c’est important de « manger bio », mais cela coûte bien plus cher. Pour d’autres, c’est le poste de dépense le moins important; ils et elles pourraient toujours manger des pâtes. Même chose pour le rapport à l’éducation : les enfants doivent-ils aller à l’école privée ou publique? Ce sont toutes des questions de valeurs qui s’expriment à travers l’argent. L’argent est un phénomène social total, pour reprendre l’expression de Marcel Mauss. Il sous-tend toutes nos décisions.
Siggi : Un phénomène que l’on remarque lorsqu’on étudie les couples hétérosexuels est la perpétuation des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes. Dans les grands médias, il est coutume de discuter des inégalités de revenus tandis que, dans les sciences sociales, on aborde souvent l’invisibilisation du travail domestique. Au-delà de ces deux aspects, quels sont les autres déséquilibres fréquemment observés?
HB : Souvent, c’est dans la mécanique du couple. La conjointe qui vient d’avoir un enfant sera généralement plus à la maison et fera donc plus de courses. Ce qu’elle paiera sera davantage liquide : la nourriture et les vêtements, ça ne survit pas au temps. L’homme travaillera souvent plus, aura un meilleur revenu et donc un meilleur crédit. Si le couple s’achète des meubles ou une automobile, le vendeur ou la vendeuse dira : « On va mettre ça à votre nom, monsieur, ça va être plus simple, vous avez un meilleur crédit. » Ce sont des achats solides, des avoirs qui se conservent. S’il advient une dispute et une séparation après 10 ans de vie commune, c’est le nom de monsieur qu’il y aura sur les grosses factures. C’est lui qui gardera les biens durables et madame reprendra ses sacs d’épicerie vides.
Une autre chose intéressante — et c’est une belle petite trouvaille de notre équipe de recherche — se situe sur le plan de la négociation. Nous nous sommes aperçu∙e∙s que les hommes négocient davantage en vases clos. Ils voient habituellement les revenus et les tâches domestiques comme deux sujets distincts. Les femmes ont plus tendance à réfléchir en vases communicants. Si elles travaillent moins, elles font plus de tâches domestiques, ayant en tête que, si leur conjoint se retrouvait un jour plus souvent à la maison, il ferait lui aussi plus de tâches domestiques. La statistique nous montre autre chose : lorsqu’une femme gagne plus que son conjoint, l’homme n’en fait pas plus à la maison.
Siggi : Notre discussion porte surtout sur les couples hétérosexuels. Qu’en est-il chez les couples de même genre?
HB : Il y a peu de différences. La personne qui a un moins grand revenu est souvent désavantagée. Aussi, quand les enfants arrivent, il faut s’en occuper. C’est presque toujours la personne la moins avancée dans sa carrière qui restera à la maison tandis que celui ou celle avec un emploi plus payant et plus stable travaillera plus. On observe alors les mêmes déséquilibres que ceux mentionnés pour les couples hétérosexuels.
Siggi : Tous ces travaux sur l’amour et l’argent vous ont-ils désillusionnée? Font-ils disparaître la « magie » amoureuse?
HB : Pas du tout! Il s’agit plutôt d’une prise de conscience et d’une meilleure compréhension des mécanismes derrière la représentation du couple. Ces réflexes amoureux, nous les avons tous et toutes.
Je dirais que c’est plutôt sur le cadre juridique que mon regard a changé. L’union libre peut vraiment désavantager des femmes en cas de rupture. Le mariage, lui, peut faciliter les choses en permettant de ne pas compter. Quand on demande aux gens pourquoi ils se marient, ils répondent : « Parce qu’on s’aime. » Ce sont des motivations affectives et non juridiques. Les avantages juridiques seront découverts par la suite : un contrat de mariage, c’est aussi un contrat de divorce. En effet, d’un point de vue économique, les femmes mariées sont plus protégées que celles en union libre lors de la séparation.
Siggi : Une sociologue qui fait l’éloge du mariage, on aura tout vu! (Rires.)
HB : Je me surprends moi-même. Lorsque j’étais plus jeune, j’avais parié que je ne me marierais jamais! (Rires.) Ce qui m’importe réellement, ce n’est pas le mariage en soi, mais plutôt son cadre légal. L’idéal serait une réforme du droit de la famille qui encadre les unions libres et protège la personne du couple la plus faible économiquement. Les contrats de vie commune existent, mais presque personne n’en signe. Parler ouvertement d’argent ou d’une éventuelle rupture brise les règles tacites des relations amoureuses.
[1] Delphine Lobet et Hélène Belleau, L’amour et l’argent : guide de survie en 60 questions, Montréal : Les éditions du remue-ménage, 2017.