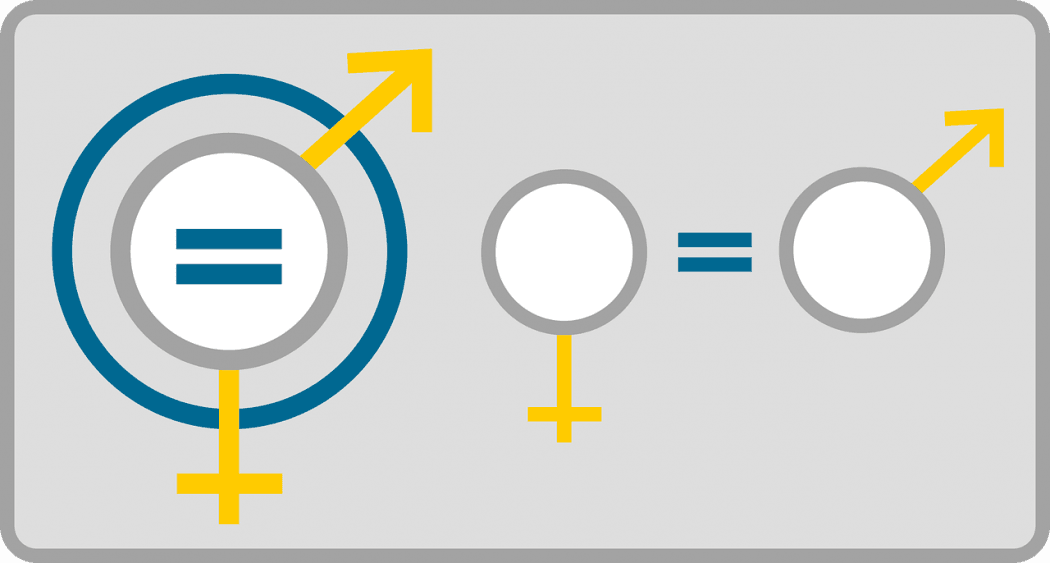par Thomas Deshaies, Catherine Paquette | Mai 1, 2020 | Analyses
La communauté algonquine de Lac Barrière (nation algonquine de Mitchikanibikok Inik) tente de forcer le gouvernement du Québec à réformer la Loi sur les mines pour que toute activité d’exploration minière sur son territoire soit précédée d’une consultation en bonne et due forme. Cette contestation juridique est une première au Québec et plusieurs jugent qu’elle pourrait avoir des impacts majeurs sur le régime minier québécois.
La communauté de Lac Barrière a intenté une poursuite en janvier 2020 contre le gouvernement du Québec pour que la Loi sur les mines soit modifiée. « C’est vraiment le régime juridique au complet, dans son essence même, qui pose problème », résume l’avocat de la communauté, Marc Bishai.
Ce qui est en cause : le mode d’attribution des titres miniers (plus communément appelés les claims). Les claimspermettent à une entreprise d’effectuer des travaux d’exploration minière afin de trouver un gisement économiquement rentable et, éventuellement, d’ouvrir une mine. Les entreprises et individus achètent des titres miniers en ligne, via l’interface GESTIM du gouvernement, pour ensuite obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux sur le territoire visé.
Pour expliquer ce qu’est un « titre minier », le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) mentionne sur son site qu’il procure « le droit exclusif d’y chercher les substances minérales » et que le « mode d’acquisition est un procédé simple et rapide » . Le régime « s’appuie sur un accès le plus large possible au territoire, un droit de recherche ouvert à tous, sans égard aux moyens des demandeurs », mentionne également le MERN.
« Le principe, c’est la liberté de prospection, ou le free mining, qui permet à quiconque d’enregistrer automatiquement, quasiment, des claims miniers et ce, sans consultation préalable de la communauté autochtone qui occupe déjà le territoire, déplore Me Bishai. C’est, selon nous, inconstitutionnel. »
« Il est dans l’intérêt de tous [et toutes], à mon avis, incluant les acteurs de l’industrie, que le régime minier soit constitutionnel parce que ça accorde une plus grande prévisibilité » — Marc Bishai, avocat
La loi constitutionnelle de 1982 oblige l’État à consulter les communautés autochtones sur les projets d’exploitation des ressources naturelles qui pourraient se développer sur leur territoire, souligne Me Bishai. C’est sur cette base que la communauté de Lac Barrière a intenté sa poursuite.
Un conflit avec une entreprise d’exploration minière
La récente contestation juridique trouve plus précisément racine dans un conflit qui a opposé, il y a quelques années, la communauté de Lac Barrière au gouvernement du Québec et à l’entreprise d’exploration minière Copper One.
La communauté protestait contre les travaux d’exploration minière aux abords de son territoire. En fait, elle s’opposait surtout à tout possible projet minier puisqu’il serait incompatible avec sa vision de l’occupation du territoire.
Un conflit qui s’est conclu en 2017 par le versement, de la part du gouvernement du Québec, d’une somme de 8 M $ à Copper One pour qu’elle délaisse ses titres miniers. « [La communauté] a alors constaté qu’il y a absence de consultation avant que des transactions aient lieu concernant des claims sur son territoire », explique Me Bishai.
Par voie de communiqué, le chef de la nation algonquine de Mitchikanibikok Inik, Casey Ratt, a déclaré en janvier dernier que la loi est, selon lui, « dépassée ». « Notre territoire comprend plusieurs sites importants d’un point de vue écologique et culturel qui sont essentiels pour assurer notre survie. Nous ferons tout en notre pouvoir pour le protéger des projets miniers risqués », a-t-il souligné.
Un dossier suivi par l’industrie
Au moment d’écrire ces lignes, la position du gouvernement dans cette affaire n’était pas connue. Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a décliné notre demande d’entrevue « puisqu’il s’agit d’un dossier judiciarisé ».
L’Association d’exploration minière du Québec (AEMQ), qui représente des entrepreneurs et des minières, a quant à elle accepté de répondre aux questions de L’Esprit libre, en se gardant toutefois de commenter en détail cette affaire.
Le directeur de projet pour l’AEMQ, Alain Poirier, précise que l’obligation de consulter les communautés autochtones est une responsabilité qui incombe au gouvernement et non à l’industrie. Il martèle que cette poursuite concerne donc davantage l’État que l’industrie. « On ne peut pas se substituer au rôle du gouvernement (de consulter). C’est lui le gestionnaire du territoire », explique-t-il.
M. Poirier concède toutefois que la poursuite sera suivie de près par les membres de l’association. « On veut savoir ce qui va en sortir comme jugement, affirme-t-il. Ce sont souvent des causes qui sont portées jusqu’en Cour suprême et les jugements viennent modifier l’approche que les gouvernements vont avoir. »
La Loi sur les mines est peu critiquée, selon l’AEMQ
Les entreprises qui souhaitent procéder à des travaux d’exploration minière aux abords des communautés autochtones recueillent toutefois les préoccupations de celles-ci avant de procéder, assure M. Poirier. « Normalement, tu vas rencontrer la communauté, tu veux les informer, parce que tu veux savoir quelles sont leurs préoccupations et s’il y a des secteurs où il ne faut pas aller », souligne-t-il. Le chargé de projet explique, à titre d’exemple, qu’il n’est pas rare qu’après discussions, des entreprises consentent à paver certaines routes ou à arrêter leurs opérations en période de chasse.
« L’industrie a évolué. L’industrie parle beaucoup plus aux gens des communautés qu’elle ne le faisait il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, parce que c’est comme cela que ça fonctionne aujourd’hui. » — Alain Poirier, directeur de projet pour l’AEMQ
De son point de vue, les contestations de la Loi sur les mines sont rares au Québec. « La Loi sur les mines a été modifiée à plusieurs reprises et on n’entend pas beaucoup de contestations ni de commentaires négatifs, juge M. Poirier. Il y a [le processus] d’octroi des claimsqui est contesté, mais par une seule communauté pour le moment. »
Seulement 4 % du territoire est claimé, selon l’AEMQ
En ce qui concerne le système d’attribution des claims, M. Poirier ne pense pas que l’industrie a une marge de manoeuvre inappropriée. « Ce n’est pas vrai que parce tu as un claim, tu peux tout faire. Tu ne peux pas exproprier les gens ou faire des travaux qui ont des impacts sur la forêt sans demander de permis », cite-t-il en exemple.
Il mentionne également que 33 % du territoire québécois est visé par une interdiction de travaux d’exploration minière ou sous contrainte. Par contrainte, il cite en exemple la présence d’aires protégées.
Il reconnait cependant que le fonctionnement actuel n’implique pas de consultation préalable avant l’obtention de claim. « À l’heure actuelle, ça ne se fait pas », constate-t-il. « La demande de claim déclenche un processus de validation du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, qui [va] valider avant de donner le droit », avance-t-il. C’est pourquoi, à ses yeux, la contestation de la procédure actuelle concerne d’abord le gouvernement, et non l’industrie.
Il précise cependant qu’il y a « une immense différence entre avoir un claim et une mine ». Seulement 4 % du territoire québécois est actuellement claimé, selon M. Poirier. « Les mines qui ouvrent aujourd’hui ont été découvertes il y a 10, 15, 20 ans, ce qui fait que c’est un processus extrêmement long », ajoute-t-il. Des travaux d’exploration peuvent s’effectuer sur de vastes territoires alors qu’un éventuel projet minier n’est développé que sur une fraction de cette superficie.
Malgré les réformes de la loi, les problèmes demeurent, selon une chercheuse
La professeure de droit à l’Université d’Ottawa, Sophie Thériault, est spécialiste des droits des peuples autochtones dans le contexte de l’extraction des ressources naturelles. Elle estime que le régime minier québécois « est structuré de telle manière à rendre impossible la consultation préalable des peuples autochtones avant l’enregistrement du claim. […] L’entrepreneur minier peut obtenir de manière unilatérale un claim, sans que l’État exerce un pouvoir discrétionnaire », précise-t-elle.
Cette situation est, selon elle, un enjeu de taille notamment pour les territoires des communautés autochtones non conventionnées et qui n’ont donc jamais été cédés. Les Algonquin·e·s de Lac Barrière font partie de ce cas de figure. « Ils [et elles] peuvent toujours revendiquer l’existence de titres ancestraux, explique Mme Thériault. Un titre ancestral en droit canadien est défini comme le droit exclusif d’occuper un territoire, de l’utiliser et de bénéficier de l’exploitation de ses ressources. »
« Il y a une collision frontale entre le régime de claim minier et le titre ancestral » — Sophie Thériault, professeure de droit à l’Université d’Ottawa
Puisque le territoire n’a jamais été cédé, l’État est dans l’obligation de consulter les communautés lorsqu’une mesure étatique est susceptible d’être préjudiciable aux droits des peuples autochtones, précise Mme Thériault. Plusieurs communautés anishinabées ont tenté par le passé de négocier un traité avec les gouvernements, mais le processus n’a jamais abouti.
« À mon avis, l’enregistrement d’un claim minier sur un territoire potentiellement détenu en vertu d’un titre ancestral devrait donner lieu à une obligation de consultation », tranche Mme Thériault, qui se dit convaincue que certaines dispositions de la Loi sur les mines ne respectent pas les droits constitutionnels des Autochtones.
« L’État au service de l’industrie minière »
Mme Thériault soutient que ces enjeux de non-respect des droits ancestraux sont connus depuis longtemps. Elle émet l’hypothèse que la logique de free mining datant du XIXe siècle a survécu aux différentes réformes de la Loi sur les mines – dont la dernière remonte à 2013 — parce que cette approche est « favorable aux investisseurs miniers ». « Les entrepreneurs [et entrepreneuses] miniers réclament haut et fort l’accès le plus libre possible au territoire pour pouvoir mener des activités d’exploration et augmenter les chances de trouver un gisement rentable », constate-t-elle.
Selon elle, le système minier est à ce point favorable à l’industrie qu’il est reconnu internationalement comme tel par les grandes entreprises minières. « L’enjeu de l’économie politique ici est de dire que l’État est au service de l’industrie minière qu’il promeut également », affirme-t-elle.
Les entrepreneurs qui investissent pour effectuer des travaux d’exploration minière s’attendent d’ailleurs à pouvoir démarrer une mine s’ils trouvent un gisement intéressant. « On s’attend à ce que, s’il y a découverte d’un gisement rentable, on ait le droit de pouvoir exploiter le gisement en question », mentionne-t-elle.
Les fondements de la loi
Les fondements du free mining proviennent des ruées vers l’or du XIXe siècle et des codes miniers qui ont été développés par les prospecteurs eux-mêmes, selon la professeure. « Ils ont fait une pression importante sur les législateurs pour que ces codes miniers servent de base pour les législations étatiques, parce que les mineurs savaient que ces codes étaient favorables à l’expansion de l’industrie minière », explique-t-elle.
Le free mining est devenu une « forme de système de pensée qui est très ancrée dans les cultures minières et dont il est très difficile de faire abstraction », ajoute Mme Thériault, pour expliquer sa non-remise en question par les gouvernements.
Un enjeu aussi pour les allochtones
Selon Mme Thériault, la décision dans l’affaire opposant Lac Barrière au gouvernement du Québec pourrait devenir un « précédent très important et susceptible d’influencer le développement du droit dans d’autres juridictions ».
Elle croit également que cette contestation pourrait être bénéfique pour les communautés non autochtones. « Dans l’éventualité où l’État est forcé de restructurer son régime minier de manière à obliger la consultation avec les communautés autochtones, on va être mieux en mesure d’intégrer des processus décisionnels beaucoup plus ouverts, puis de laisser une place beaucoup plus grande aux démocraties locales », conclut-elle.
Le traitement de cette contestation judiciaire sera retardé en raison de la pandémie.
Photo : Peter B. Carter sur Flickr

par Catherine Paquette, Alec White | Fév 6, 2020 | Entrevues
Catherine Thomas et Audrey-Anne Dugas auront finalement crié assez fort : le milieu de l’humour est en train de se rallier, lentement mais sûrement, à leur mouvement de lutte contre les violences sexuelles nommé Pour les prochaines. Alors que les deux humoristes tentent depuis le mois de mai d’ouvrir la discussion au sujet de la culture du viol en humour, voilà quede gros joueurs de l’industrie joignent leurs forces. Trajectoire d’un mouvement qui s’attaque « à un véritable monstre ».
Tout a commencé au printemps 2019, en plein cœur d’une controverse déclenchée par l’envoi massif d’une liste noire par un groupe appelé Les Anonymes. La liste, en deux parties, révélait des noms d’individus ainsi que des « comportements problématiques ». Alors que plusieurs ont crié à la diffamation, Catherine Thomas et Audrey-Anne Dugas y ont vu un cri de détresse de la part de leurs collègues féminines tentant de dénoncer des gestes et agressions. Les jeunes femmes ont pris leur courage à deux mains et ont rédigé le manifeste de Pour les prochaines, qu’elles ont présenté en conférence de presse. Leur objectif? Rassembler le milieu de l’humour dans la recherche de solutions et la mise en place de ressources tant pour les victimes que pour les agresseurs. Les solutions proposées vont de la formation aux suivis psychologiques à la création de plateformes de discussions, en passant par la mise en place de protocoles de dénonciation clairs dans les milieux de travail.
Après six mois d’efforts, de réflexion et de représentations auprès de l’École nationale de l’humour, de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) et de Juste pour rire, le lancement officiel de Pour les prochaines a finalement eu lieu le 25 novembre dernier. Rassemblé au Groove Nation, sur le Plateau-Mont-Royal, un public majoritairement féminin a assisté à un panel de discussion faisant le point sur la situation des violences sexuelles dans le milieu de l’humour et de la culture, ainsi qu’à un cabaret humoristique avec six artistes invité·e·s. Toutes ces activités se sont d’ailleurs déroulées lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
« On est vraiment très heureuses de vous voir ici ce soir, parce que le soutien se fait frileux, et les contrecoups font mal, mais c’est de bonne guerre, la violence et les contrecoups font croire que l’on est en train de combattre quelque chose de réel », a déclaré Audrey-Anne Dugas. Depuis la conférence de presse, les deux humoristes affirment sentir une méfiance à leur égard et avoir essuyé plusieurs refus lorsqu’elles tentaient de se produire en spectacle.
La salle presque comble et la présence de docteure Christelle Paré sur le panel, première agente de recherche embauchée par le groupe Juste pour rire, laissaient croire que le sujet est pris au sérieux par les plus gros joueurs de l’industrie, et qu’elles ne sont plus seules à dénoncer les violences sexuelles. Selon une étude réalisée par docteure Paré, en collaboration avec l’Université Carleton et le Groupe de recherche sur l’industrie de l’humour, 52 % des femmes humoristes disent avoir été victimes de gestes à caractère désobligeant de nature sexuelle dans leur milieu de travail, et 78 % disent avoir été victime de paroles à caractère désobligeant de nature sexuelle1. Les perceptions des hommes et des femmes recueillies lors de cette étude montrent que ce milieu de travail est toujours traversé de stéréotypes prononcés, ce qui fait en sorte que les femmes humoristes sont soumises à davantage de pression. « Quand j’ai fait ma thèse sur le milieu de l’humour québécois en 2011-2012, il y avait encore des gestionnaires de salles qui me disaient qu’une femme n’est pas aussi drôle qu’un homme, qu’une femme devrait vouloir se faire séduire par l’humour d’un homme et pas le contraire », a souligné la chercheuse.
Christelle Paré était accompagnée sur scène de Michaël Lessard, avocat spécialisé en droit des victimes de harcèlement sexuel, et de la chorégraphe Geneviève C. Ferron, qui a dénoncé à maintes reprises les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans le milieu de la danse. Le panel était animé par Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles, qui a souligné le courage de toutes celles qui dénoncent leurs agresseurs dans le milieu de l’humour. Selon les panélistes, ce milieu est particulier puisque la hiérarchie, la popularité et la réputation y sont des valeurs importantes alors que les humoristes y ont le statut de travailleur·euse·s autonomes. « Il y a un rapport de force qui vient prévenir la dénonciation. Souvent, les personnes qui commettent les gestes sont en position de pouvoir, et c’est d’autant plus concret dans une industrie avec autant de travailleur·euse·s autonomes », a expliqué l’avocat. Par ailleurs, pour Me Lessard, « l’humour tombe dans des creux juridiques : parce qu’il existe des mesures où dans d’autres milieux de travail, si tu es victime d’un acte criminel, tu as droit à 26 semaines de congé. Mais ça, ça n’a aucun sens dans le milieu culturel, prendre 26 semaines de congé de la scène. »
Il a en effet été ardu de convaincre différentes institutions de la spécificité du problème dans le milieu de l’humour puisque plusieurs ressources sont déjà en place pour lutter contre le harcèlement sexuel au Québec. « On a passé les derniers mois à se questionner beaucoup, à se demander il était où le problème, parce que les institutions nous disent avoir des ressources, mais les victimes se sentent quand même démunies et sans recours » a expliqué la porte-parole, Catherine Thomas. Les porte-paroles disent avoir recueilli des dizaines de témoignages à la suite de leur conférence de presse, les poussant à redoubler d’efforts pour sensibiliser leurs collègues humoristes et gestionnaires.
Dans le milieu, au moment de la sortie de Pour les prochaines, les camps étaient divisés. D’un côté, « tout le monde qui a une carrière ne veut pas s’embarquer là-dedans. Et tous les gens avec des comportements problématiques se sont « hyperbackés » entre eux. C’est souvent des personnes avec des carrières. Ça fait juste mettre en relief à quel point la culture du viol est une culture toxique », explique Catherine Thomas. D’un autre côté, Mélanie Lemay note qu’« il y a beaucoup de personnes à qui on a parlé dans le milieu qui sont très intéressées à s’impliquer, mais qui craignent aussi toutes les réactions ».
« Gangrené par la culture du viol »
Maintenant que plusieurs partenaires ont dit reconnaître la spécificité du problème, Catherine Thomas et Audrey-Anne Dugas se font plus conciliantes. Mais lors d’une première entrevue avec L’Esprit Libre, les porte-paroles de Pour les prochaines ne mâchaient pas leurs mots en affirmant que le milieu de l’humour québécois était « gangrené par la culture du viol »2. Selon elles, cette culture fait en sorte que les violences sexuelles se trouvent trop souvent banalisées par le milieu de l’humour québécois. S’exprimant de diverses manières, elles se glissent insidieusement dans le quotidien des professionnel·le·s du milieu, qu’ils ou elles travaillent sur scène, en coulisse, voir même dans la salle auprès des spectateurs et spectatrices. Le problème est omniprésent et dépasse le milieu de l’humour, reconnaissent-elles, mais il prend une couleur spécifique sur scène et en coulisse.
« Ce que je trouve différent avec le milieu de l’humour, c’est que l’individu est non seulement un individu, mais une entreprise aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont intérêt à faire en sorte que cette personne conserve son image du bon gars, du gars drôle. […] Les inconduites sexuelles, c’est une affaire de pouvoir, et dans le milieu de l’humour, la hiérarchie et le pouvoir, c’est excessivement clair. T’es populaire, t’as de l’argent, t’as fait tel show, t’as pas fait tel show. C’est hyper, hyper hiérarchisé », témoigne Catherine Thomas.
Selon les deux humoristes, le milieu professionnel humoristique lui-même a évolué sur des bases permettant d’instaurer des climats de travail désagréables pour certaines femmes. À ce sujet,, Audrey-Yanne Dugasrappelle toute la controverse autour du festival Juste pour rire, créé en 1983 : « L’humour sexiste, c’est tellement présent au Québec. En quelque part, qui a bâti l’industrie de l’humour au Québec? C’est Gilbert Rozon. Et y’avait pas juste lui. Autour de lui, y’a eu tous ses buddys qui ont fait en sorte que c’était ça, l’humour. Même à l’École [nationale de l’humour], ils continuent de faire entrer des individus problématiques. » (NDLR: une première version de cet article attribuait cette citation à Catherine Thomas, alors qu’elle est de Audrey-Yanne Dugas)
Mais il n’y a pas que les blagues sexistes. Pour les prochaines s’inspire en partie de la liste de comportements dénoncés par Les Anonymes pour dresser le portrait du problème qui se construit depuis les débuts de l’industrie de l’humour : effleurements et attouchement non désirés, manipulation dans l’optique d’obtenir des faveurs sexuelles, sollicitation de photos nues, campagnes de salissage, agressions et harcèlement, violences envers des travailleuses du sexe. Le « monstre » auquel s’attaque Pour les prochaines fait bien des ravages, décourageant par ailleurs plusieurs femmes de persister dans le milieu, soulignent les deux instigatrices du mouvement.
Par ailleurs, deux ans après son avènement, le mouvement « Moi aussi » est loin d’avoir réglé les choses, confirment-elles. C’est plutôt un « déplacement vers d’autres victimes » qui se serait effectué. Plutôt que de s’adresser aux humoristes bien établies, les agresseurs viseraient désormais les plus jeunes, ou les membres d’équipes situées plus bas dans la « hiérarchie » de l’humour, telles que les « filles à la porte », constatent Thomas et Dugas.
Réponse collective à un problème systémique
Pour les prochaines appelle à des actions concrètes afin de mieux protéger les personnes qui souhaitent faire un signalement d’agression sexuelle, en plus de désamorcer le système dans lequel les violences sexuelles sont choses du quotidien. Le cœur de leur demande : que le respect envers les femmes humoristes soit inscrit dans « l’éthique humoristique » et que les ressources mises en place protègent les personnes, hommes ou femmes, qui dénoncent des gestes. Pour s’attaquer au problème, elles ont fait appel à la spécialiste Mélanie Lemay, cofondatrice de « Québec contre les violences sexuelles ».
« Il y a des gens aussi qui sont autour, qui sont témoins, je pense à des agent·e·s, à des personnes qui sont sur place pour observer et qui connaissent le comportement des personnes qu’elles et ils côtoient, et donc ça prend aussi des gens qui ont plus de leviers pour dévoiler, parce que ça ne doit pas toujours tomber sur les épaules de la victime », souligne-t-elle.
Mélanie Lemay renchérit en entrevue avec L’Esprit Libre : « Les agressions sexuelles, ça se construit. Ça commence par un climat social. Donc on doit déconstruire un peu la culture qui est autour. Et c’est certain que quelque part, ça doit s’imbriquer aussi dans les espaces qui produisent cette violence-là. » Ainsi, c’est souvent lors des après-show, dans des lieux ou des moments parallèles à la scène qu’ont lieu les comportements problématiques, comme dans les loges, les bars, voire dans un véhicule pour se rendre sur les lieux d’un spectacle : « Si tu te fais pogner les seins dans une loge, si tu fais deux heures de route avec quelqu’un qui met sa main sur ta cuisse, qu’est-ce tu fais? » se demande Audrey-Anne Dugas. Ces gestes qui peuvent sembler minimes en apparence laissent des marques et placent la victime dans une situation où la dénonciation peut être « très compliquée », démontre-t-elle.
Les panélistes rassemblé·e·s au Groove Nation le 25 novembre ont aussi souligné que l’ensemble des représentant·e·s du milieu doivent s’y mettre afin de pouvoir intervenir en cas de comportements problématiques, mais également pour désamorcer cette culture sexiste. « C’est un problème collectif. Si on est tout seul à porter le ballon, on va pas le porter longtemps. C’est une responsabilité partagée de l’industrie. […] [Juste pour rire] a des artistes partout, sur toutes les scènes, c’est difficile d’avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, donc si tout le monde ne travaille pas, il va rester des failles », a souligné Christelle Paré. Son embauche est d’ailleurs un signe que l’entreprise est en train de changer, après des mois de controverses au sujet de son ex-président Gilbert Rozon, dont le procès pour viol et attentat à la pudeur débutera en 2020.
Des outils déjà en place?
La directrice de l’École nationale de l’humour, Louise Richer, dit avoir constaté de nombreux malaises depuis que Gilbert Rozon a quitté Juste pour rire, en octobre 2017. Bien qu’elle n’ait pas pu assister au premier évènement de Pour les prochaines, elle se dit tout à fait consciente du problème, et souligne avoir « hâte » d’avoir une conversation au sujet des violences sexuelles. « Pour les prochaines montre que le problème est loin d’être contenu, et qu’on doit se demander quelles sont les meilleures actions à favoriser. D’abord, et ce qui est extrêmement important pour moi, c’est qu’il faut avoir le sentiment que l’École [nationale de l’humour] est un lieu sécurisé où les gens vont se sentir à l’aise d’aller parler de ce qui se passe, ou capables de le gérer. […] Je veux m’assurer que la conversation soit perçue comme étant possible et soit valorisée dans l’espace où nous sommes », a-t-elle expliqué à L’Esprit Libre.
L’École nationale de l’humour s’est par ailleurs dotée d’une nouvelle Politique visant à prévenir et combattre les violences sexuelles3 au mois d’août, en prévision de la rentrée scolaire 2019, conformément à la révision de la Loi sur les normes du travail québécoise qui exige que toute entreprise se dote d’une politique de prévention du harcèlement. La Politique stipule que toute plainte sera reçue par l’ombudsperson de l’École et détaille le type de soutien à offrir et de sanctions à prendre ainsi que des mesures pour prévenir les représailles.
L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) s’est aussi déclarée ouverte à la discussion. Cette dernière a rejoint tou·te·s ses membres par courriel au mois de juin pour publiciser sa Politique contre le harcèlement au travail, laquelle ne se trouve pourtant pas dans la section publique de son site Internet. L’APIH fait aussi partie d’un comité réunissant plus de 40 associations du secteur culturel qui se préoccupe du dossier du harcèlement.
Le milieu de l’humour et l’industrie de la culture ont également publié la Déclaration pour un environnement de travail exempt de harcèlement dans le milieu culturel québécois4, une ressource à cet égard nommée l’Aparté5 ayant été mise sur pied. En collaboration avec la clinique juridique Juripop, l’Aparté offre au milieu culturel de l’assistance gratuite et confidentielle au sujet des cas de harcèlement psychologique, sexuel ou de violences au travail. Pour sa part, l’Institut national de l’image et du son (INIS) a créé un site Internet « Il était une fois… de trop », destiné à sensibiliser le public au harcèlement dans le milieu culturel.
Or, malgré ces nouvelles mesures importantes prises par des acteurs de l’industrie, et malgré les dialogues qui se sont tenus depuis la sortie de Pour les prochaines, l’essentiel du travail reste à faire. Selon Mélanie Lemay, beaucoup de ressources sont toujours « inadéquates ». À ses yeux, il faudrait que les personnes en situation d’autorité réussissent à faire en sorte que la responsabilité de la dénonciation ne repose plus seulement sur les épaules des victimes. « Il y a un écart entre s’entendre collectivement pour dire que la violence sexuelle est inacceptable et être sur le terrain ensuite pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’agression », résume-t-elle.
Les porte-paroles expliquent par ailleurs que les mesures disciplinaires et les suspensions contre les personnes dénoncées ont un effet pervers : conscientes des conséquences potentielles sur la carrière de leur agresseur·euse, les victimes peuvent craindre davantage de le dénoncer, voyant d’importantes représailles leur pendre au bout du nez.
Sur ce point, les instigatrices du mouvement, ainsi que Mélanie Lemay, jugent important de « détabooiser » le sujet afin de plutôt encourager certaines personnes à suivre des formations et à parler de leurs gestes problématiques avec des professionnels : « On veut leur donner les outils pour qu’il y ait une responsabilisation, et qu’on puisse vivre en société selon ce qu’on a décidé ensemble dans la Charte des droits et libertés. Il ne faut pas que tout repose sur une judiciarisation, le but est d’aider ces personnes. En leur offrant des ressources, on leur rend service », explique Mélanie Lemay. Il a notamment été proposé de créer un guichet unique pour les dénonciations, d’offrir un financement pour des thérapies et de trouver une solution pour donner aux victimes la possibilité de prendre une pause du milieu sans que ça n’accentue leur précarité financière.
Au-delà de la dénonciation, Pour les prochaines propose donc de tendre la main à l’ensemble du milieu pour que celui-ci éradique le problème des violences sexuelles. Ainsi, Audrey-Anne Dugas et Catherine Thomas souhaitent que leur démarche puisse ouvrir un dialogue et mener à une prise de conscience ainsi qu’à générer de l’aide et du soutien à tous les membres du milieu de l’humour plutôt que d’ouvrir une chasse aux sorcières.
Photo : Mélanie Lemay, de Québec contre les violences sexuelles, avec les humoristes Audrey-Anne Dugas et Catherine Thomas.
Crédit : Pour les prochaines
1 Christelle Paré et François Brouard, Enquête sur le portrait sociodémographique et l’égalité homme-femme chez les créatrices et créateurs d’humour au Québec. Sommaire 2018-2 : Données sur la perception de l’égalité entre les hommes et les femmes, Université Carleton, Groupe de recherche sur l’industrie de l’humour (GRIH), 2018. carleton.ca/profbrouard/wp-content/uploads/humoursommaire2018-2egalitehommesfemmes20180609final.pdf.
2 « La culture du viol, ce sont toutes ces pratiques, mythes, conventions et faits culturels qui banalisent, dénaturent ou favorisent les violences sexuelles dans notre société. On en retrouve des éléments dans les arts, le droit, la politique; dans des phénomènes comme le blâme des victimes et la socialisation genrée » ; Suzanne Zaccour, La fabrique du viol, Montréal : Leméac, 2019, p. 76.
3 École nationale de l’humour, Politique visant à prévenir et combattre les violences sexuelles, Montréal, 2019. enh.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-sur-les-violences-sexuelles-ENH_21-aou%CC%82t-2019.pdf
4 Union des artistes, Déclaration pour un environnement de travail exempt de harcèlement dans le milieu culturel québécois, Montréal, 2017. uda.ca/sites/default/files/docs/Pdf/de-claration-harce-lement-2017-12-13vf.pdf
5 Clinique juridique Juripop, L’Aparté : Ressources contre le harcèlement et les violences en milieu culturel, 2019. aparte.ca/
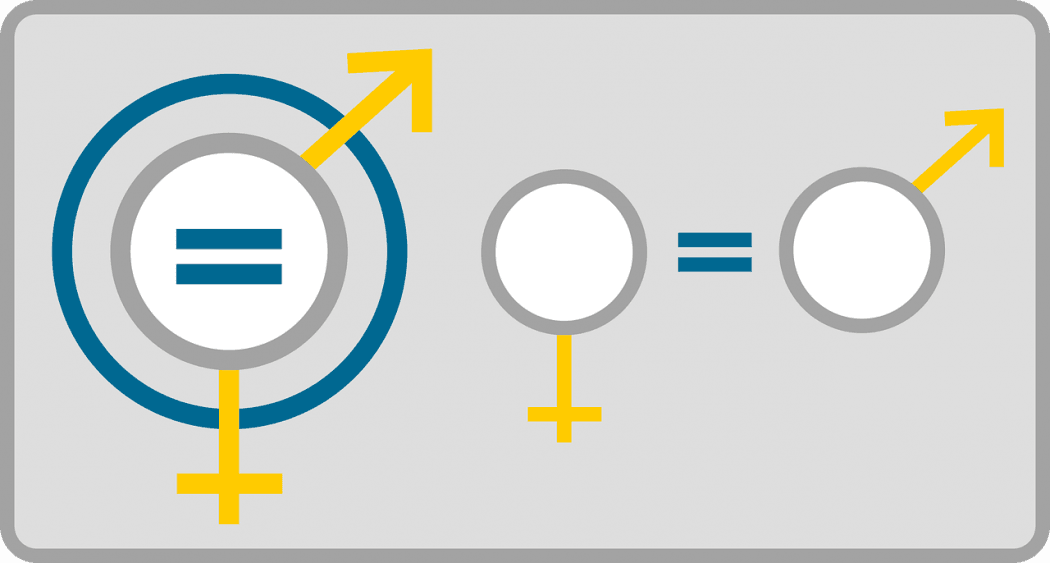
par Catherine Paquette | Avr 12, 2019 | Analyses, Societé
La comédienne Sophie Lorain a causé un tollé en avril 2018 en déclarant à Tout le monde en parle n’avoir « rien à cirer » de la parité hommes-femmes et des quotas récemment mis en place par les institutions québécoises et canadiennes de financement en cinéma. Plusieurs chroniqueurs se sont emparés de la question et ont tour à tour discuté de l’approche de discrimination positive adoptée au Québec. Il y a en effet au Québec et au Canada des programmes gouvernementaux et autres initiatives qui visent l’augmentation des effectifs féminins dans les lieux de travail. Mais qu’en est-il? Ces mesures sont-elles de trop ou sont-elles suffisantes? Doit-on aller plus loin et viser un nombre égal de femmes et d’hommes dans chaque milieu? Et surtout, l’atteinte de la parité au travail est-elle possible sans de grands changements sociaux qui amèneront, eux aussi, une égalité réelle entre les hommes et les femmes?
Une panoplie d’exemples et de statistiques montrent que les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours bien présentes sur le marché du travail au Québec, et ce, non seulement dans le milieu cinématographique, mais dans bien des domaines.
Un rapide coup d’oeil aux statistiques de la province permet de constater que les femmes sont toujours surreprésentées dans les métiers les moins payants, comme ceux d’adjointes administratives, de vendeuses dans le commerce de détail, de caissières, d’éducatrices en centre de la petite enfance et d’infirmières. Elles peinent à franchir les frontières des domaines comme la finance, la technologie, l’ingénierie, la construction, se butant aux stéréotypes, aux biais inconscients ou aux remarques mesquines de leurs collègues, ou peinent à conjuguer vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, de manière générale, une femme québécoise ne gagne en moyenne que 87 sous pour chaque dollar gagné par un homme1.
Par ailleurs, à l’échelle du Canada, 19 % des femmes actives sur le marché du travail occupent un emploi à temps partiel, comparativement à 5,5 % des hommes actifs, ce qui explique en partie que le revenu moyen des Canadiennes soit lui aussi plus bas que celui des Canadiens2.
Il y a pourtant au Canada et au Québec des mesures visant à réduire les écarts entre les hommes et les femmes dans divers domaines professionnels, jumelés à des programmes sociaux de conciliation travail-famille, par exemple. L’idée de la parité, c’est-à-dire l’atteinte d’un nombre égal de femmes et d’hommes dans un milieu donné, est toutefois sujette à débats, tout comme les moyens à prendre pour faire une plus grande place aux femmes dans les milieux masculins. C’est à la fois la nécessité — ou non — d’atteindre une « parité » et les outils suggérés que cet article souhaite éclairer.
Distinguer la discrimination positive, la parité et les quotas
Au Québec, la première politique d’égalité en emploi pour les femmes dans la fonction publique québécoise a été adoptée en 1980. Cette politique visait une meilleure représentation des femmes et des hommes dans le secteur public, mais ne comprenait pas la mise en place de mesures de discrimination positive. Des mesures pour cinq groupes cibles (femmes, minorités visibles, minorités culturelles, personnes handicapées, peuples autochtones) sont devenues légalement possibles après des modifications à la Charte des droits et libertés de la personne qui ont eu lieu en 19823.
Des programmes d’accès à l’égalité professionnelle ont par la suite été implantés en 1987, et sont effectifs depuis dans les organismes publics. En 2018, le Québec a toujours pour objectif d’atteindre 25 % de représentation des groupes cibles dans la fonction publique4. Aussi, une entreprise de la province voulant conclure une affaire avec le gouvernement ou obtenir une subvention doit démontrer son application de la loi en mettant en place des mesures de discrimination positive envers les groupes minoritaires mentionnés ci-haut. Depuis son apparition dans les années 1980, la formule : « à compétences égales, il faut embaucher une personne issue d’un groupe minoritaire » est devenue chose commune dans le jargon des employeurs et employeuses.
Toutefois, ces mesures de discrimination positive n’ont pas pour objectif l’atteinte de la parité hommes-femmes, idée selon laquelle il faudrait un nombre égal d’hommes et de femmes dans certains milieux. Elles visent plutôt l’égalité des chances dans l’accès au poste ou à la promotion disponible dans un milieu de travail. En effet, aucun « quota » n’est imposé aux entreprises afin que leurs effectifs féminins et masculins soient équivalents. La parité n’est pas l’objectif de la majorité des départements de ressources humaines québécois. Les milieux professionnels actuels misent plutôt sur une représentation proportionnelle des candidatures reçues, souligne la professeure Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’Université TÉLUQ et spécialiste de la sociologie du travail, en entrevue avec L’Esprit libre. C’est à dire que si le bassin d’embauche est généralement composé de 30 % de femmes et 70 % d’hommes, les embauches devraient refléter cette réalité5.
Un quota?
L’idée des « quotas » apparaît surtout dans les discussions à propos du monde politique, des conseils d’administration, ou encore du financement public de projets artistiques ou académiques. Les groupes décisionnaires qui sont élus sur des comités de ressources humaines, par exemple, se posent de plus en plus la question de la représentation des femmes et groupes minoritaires, ajoute Mme Tremblay. Cela dit, il est rare que les milieux professionnels ou les entreprises choisissent des démarches où un certain objectif est fixé quant au nombre de femmes à embaucher. Comme mentionné plus tôt, le monde du travail s’efforce plutôt d’appliquer la formule du « à compétences égales » et de se rapprocher des proportions du bassin de candidatures.
Ces programmes ne font toutefois pas des miracles, même dans leur volonté de représenter les bassins de candidat·es. Puisque les programmes régissant l’accès au marché du travail suggèrent de favoriser les personnes en situation minoritaire, « à compétences égales », le choix des gestionnaires devient rapidement très subjectif, constate la professeure Tremblay. L’embauche de ces personnes dépend de la bonne volonté des têtes dirigeantes, qui sont chargées d’évaluer les compétences des candidat·es. C’est d’ailleurs le caractère subjectif de cette sélection qui pousse les professeures interrogées pour ce texte à demander un suivi plus serré de la mise en application de ces programmes d’accès. À leurs yeux, les mesures incitatives ont permis de faire des gains considérables, mais l’imposition de mesures obligatoires pourraient éventuellement constituer une solution pour faire une plus grande place aux femmes dans les milieux masculins.
Viser la parité
La question demeure : pourquoi ne pas aller plus loin en mettant en place des quotas au sein même des entreprises?
Aux États-Unis, une solution se rapprochant des quotas a été utilisée dans le domaine des technologies. Plutôt que de donner des objectifs fixes, des entreprises ont choisi de donner des primes à des gestionnaires qui faisaient augmenter les effectifs féminins d’une manière ou d’une autre. « Les primes ont forcé les gestionnaires à être un petit peu plus proactifs. Apparemment, ça a fonctionné, dans la Silicon Valley, dans beaucoup d’entreprises, il y a des hommes qui ont eu ces primes. […] C’est une technique qui n’est pas généralisée, mais certaines entreprises l’ont fait. Un bon nombre d’entre elles ont vu des résultats positifs, et ça pourrait être intéressant de faire ça ici », affirme Diane-Gabrielle Tremblay. Le Québec est toutefois loin du compte, puisque ses programmes d’accès à l’égalité professionnelle ont peu d’impact sur les entreprises privées.
À la Confédération des syndicats nationaux (CSN), cette discussion autour de la parité, des quotas et de la discrimination positive est récurrente, a expliqué la vice-présidente lors d’une entrevue avec L’Esprit libre. Mais comme dans le monde du travail, l’application de mesures visant la parité se limiterait à la structure même de l’organisation, soit au comité exécutif, conseils centraux et locaux, et autres instances décisionnelles. C’est-à-dire que sur les instances où elles peuvent être élues, les femmes pourraient éventuellement avoir des sièges « réservés » pour assurer une représentation des membres plus équitable.
« Je ne vous cacherai pas que les représentantes de la CSN à la condition féminine réfléchissent. On a parlé beaucoup de mesures paritaires, de mixité. Mais dans les milieux de travail, on va plutôt parler de programmes d’accès à l’égalité qui se calquent sur la loi qui a été adoptée, notamment dans les milieux non traditionnels », explique la vice-présidente de la CSN, Véronique De Sève.
Elle donne également un exemple hors du commun qui date des années 1980 au Québec : En 1988, à Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue, le Syndicat des employé·es de Temfor (l’entreprise se nomme Temlam Inc.), a négocié une clause de parité hommes-femmes à l’embauche. Aujourd’hui, dans cette scierie de Ville-Marie, il y a 52 femmes et 52 hommes. Il s’agissait d’une idée avant-gardiste à l’époque, qui reste surprenante même encore aujourd’hui, compte tenu du faible pourcentage de femmes qui travaillent dans l’industrie de la construction6.
L’exemple pourrait-il inspirer le milieu syndical actuel? Lorsque questionnée à savoir si la CSN pourrait un jour suggérer à ses centrales locales de forcer les gestionnaires à former des équipes paritaires, la vice-présidente acquiesce. « Ce n’est pas impossible! On dit souvent que la CSN, c’est le reflet de la société. Parfois, on entend des gars dire que les femmes ont pris trop de place… Je me dis que peut-être qu’un moment donné, on n’aura pas le choix », dit-elle. Mais elle reste prudente : pour l’instant, l’idée d’imposer des mesures pour atteindre la parité se limite aux instances où des élections ont lieu.
En entrevue avec L’Esprit libre, la chercheuse de l’Université Laval Hélène Lee-Gosselin insiste pour dire que les quotas et mesures de discrimination positive seront nécessaires pour faire changer les choses.
« Tout ce que ça fait les quotas, c’est que ça oblige les personnes qui sont dans des postes clés à chercher les remplaçants dans leurs postes, au-delà du réseau qu’ils regarderaient d’habitude, en utilisant d’autres moyens. Ce ne sont pas juste les humains qui sont des créatures d’habitudes, les milieux le sont aussi. Leurs habitudes ont tendance à les avoir servis eux-mêmes, alors ils reproduisent les mêmes modèles », regrette Mme Lee-Gosselin, qui est directrice de l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (IFSEE) à l’Université Laval.
La professeure tient à déconstruire l’argument qu’apportent de nombreux chroniqueur·euses et certaines femmes. Cet argument, selon la professeure, consiste à dire que le talent et les compétences d’une personne seraient son seul vecteur de succès, sans égard à son sexe ou son milieu d’origine. Mme Lee-Gosselin affirme que cette vision des choses est erronée : « L’hypothèse que [ces personnes] ont, c’est que seul le mérite compte pour avoir sa place au soleil. Mais la vraie vie, c’est qu’il y a des facteurs de chance, des facteurs de mérite, et des facteurs qui sont liés aux positions sociales qu’on occupe. Et ça, par définition, c’est structuré dans le social. Ce n’est pas juste le produit de nos efforts et de notre talent », explique-t-elle.
Combien de femmes faut-il?
La professeure explique que l’atteinte de la parité, d’un réel 50 %-50 % ou du moins d’une zone paritaire, serait nécessaire pour allouer un plein pouvoir aux femmes au travail et réduire les situations discriminatoires qu’elles vivent lorsqu’elles intègrent des milieux masculins.
Il y a à ce sujet de nombreux écrits, dont celui de la chercheuse américaine Rosabeth Moss Kanter. À la fin des années 1970, dans son bureau de l’Université Harvard, la chercheuse développe une théorie sur le pouvoir des minorités dans les entreprises. Constatant le faible pouvoir décisionnel donné aux employé·es des entreprises, elle suggère de modifier les structures afin de permettre une meilleure productivité. Son ouvrage Men and Women of the corporation devient après sa parution en 1977 un classique des études de gestion et propulse Rosabeth Moss Kanter au rang des personnes les plus influentes en Amérique.
Parmi ses hypothèses, on retrouve l’idée que le pouvoir dans le milieu de travail est distribué de façon désavantageuse pour les femmes, les hommes se retrouvant avec plus d’outils et de marge de manœuvre pour faire leur place7. Les employées des grandes entreprises n’ont donc pas la force nécessaire au sein de l’organisation pour faire entendre leurs besoins et intérêts.
Selon Rosabeth Moss Kanter8, les personnes isolées, par exemple les femmes, sont des « jetons » tant et aussi longtemps qu’elles ne seront pas représentées en plus grand nombre. En-dessous de 10 ou 15 %, les femmes dans les entreprises apparaissent donc comme des intrus et subissent une plus grande discrimination. Ce n’est que lorsqu’elles atteignent un nombre suffisant pour former un groupe (35 %) que les femmes acquièrent le pouvoir de se faire entendre parmi leurs collègues masculins et qu’elles peuvent se regrouper pour faire face aux préjugés. Seules, elles ne peuvent porter la responsabilité de faire changer les mœurs, mais en groupe, leur voix est plus forte.
La professeure Gosselin affirme toutefois que même la masse critique proposée par Rosabeth Moss Kanter pourrait être insuffisante. En effet, plusieurs équipes de recherche auraient plus tard testé les hypothèses de Kanter, pour se rendre compte que la parité était nécessaire à une meilleure performance et ambiance de travail. « Leur conclusion était que même autour de 40 %, les stéréotypes de sexe interféraient encore et ils postulaient qu’il faudrait probablement 50 % pour que les nombres de femmes soient assez grands, dans les groupes, pour que les biais cognitifs, perceptuels, de mémoire et d’attribution aient moins d’impact », affirme la professeure.
Cette théorie de la masse critique a été adulée, puis critiquée par des académicien·ne·s qui ont prouvé que les discriminations envers les femmes ou les minorités ne sont pas qu’une question de nombre9. Certains écrits soulignent aussi que la culture de l’entreprise ou les rôles genrés de pouvoir dans la société peuvent rendre le quotidien des femmes au travail plus difficile, et ce malgré un nombre plus ou moins grand d’effectifs féminins dans le milieu d’emploi.
Pensons aux obstacles auxquels font face ces pionnières qui ouvrent le chemin dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes : la professeure Diane-Gabrielle Tremblay a pu constater divers obstacles auxquelles les femmes « jeton » font face lorsqu’elles accèdent à l’emploi dans un milieu majoritairement masculin. Au cours de ses recherches dans le monde des technologies de l’information, où les femmes sont toujours minoritaires, elle a été à même de recueillir de nombreux témoignages de cette discrimination. C’est en particulier dans le milieu de la programmation que les barrières ou les inconvénients sont les plus notables pour les femmes qui bénéficient — ou non — des mesures de discrimination positive.
« Il y a des femmes qui disent qu’elles sont exclues des échanges. Elles disent que les gars se font des petites réunions, des petites rencontres, des courriels, et considèrent que ce sont eux, les sages, et que les femmes sont exclues du groupe. […] Des femmes au Québec ont témoigné aussi qu’elles étaient moins prises au sérieux dans les réunions. Par exemple, quand elles proposent quelque chose, les gens les écoutent, mais la conversation continue. Par contre, quand c’est un homme, on trouve que c’est une bonne idée », raconte la chercheuse.
Dans certains milieux affiliés à la CSN, la situation est la même, fait valoir la vice-présidente Véronique De Sève. Les femmes qui font leurs débuts en horticulture, ou dans les usines, se butent à des obstacles aussi banals que des toilettes féminines installées à l’autre bout de l’immense entrepôt, ou au regard plein de jugement des hommes qui transportent des charges lourdes10.
Ces constatations amènent Mme Gosselin à rappeler que les gestionnaires des entreprises, tout comme les syndicats, ont un rôle à jouer dans le maintien de ces femmes en emploi et dans l’amélioration de leurs conditions de travail.
Par ailleurs, il a aussi été démontré à plusieurs reprises que les hommes bénéficiaient aussi des ajustements demandés par les femmes, lorsque leur nombre augmentait. Par exemple, la mise à jour des techniques employées pour soulever des objets lourds a souvent fait baisser le nombre de blessures chez les hommes, comme chez les femmes, fait savoir la vice-présidente de la CSN.
Entreprendre le changement sur le plan global
Les professeures interrogées, ainsi que les textes critiquant la vision de Rosabeth Moss Kanter, soulignent que les quotas et les mesures de discrimination positive ne sont qu’une seule façon parmi tant d’autres pour se rapprocher de la parité dans les milieux de travail. Madame Lee Gosselin, bien qu’elle mette de l’avant la théorie de Moss Kanter, explique que les inégalités dans les milieux de travail sont le symptôme d’un problème plus systémique : pour elle, c’est toute la société qui doit évoluer afin de donner aux femmes un statut égal aux hommes.
Lorsqu’on prend du recul sur la question des inégalités hommes-femmes, on retrouve des plaidoyers comme ceux d’Alexa Conradi selon lesquels les rapports de pouvoir et les stéréotypes de genre rendent toujours possible une domination masculine au sens large dans la société11. Ces stéréotypes ont aussi un impact sur la façon dont les femmes s’autoévaluent : les participantes au podcast URelles, des femmes qui travaillent dans le milieu informatique, reconnaissent que les programmeuses « osent moins que les hommes »12 lorsqu’il est temps de poser leur candidature pour un emploi pour lequel elles n’ont pas 100 % des compétences demandées, ou pour ce qui est de demander une promotion, alors que leurs homologuent masculins foncent davantage.
Il va de soi que la transformation des milieux de travail devrait aller main dans la main avec d’autres changements, non seulement au bureau ou à l’usine, mais aussi à l’école, à la maison, etc.
Pour des milieux de travail plus égalitaires, plus performants, plus sécuritaires, et même plus créatifs, il y a lieu de mener une réflexion sur la façon dont on fait place aux femmes et à toutes les personnes victimes de discriminations, et non pas seulement au travail, mais dans tous les domaines de la vie privée et publique.
CRÉDIT PHOTO: Cat6719, Pixabay
1 Marie-Josée Marcoux et Sylvie Bouchard, mai 2016, Portrait statistique Égalité femmes hommes Ensemble du Québec, Conseil du statut de la femme, Québec. www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_national_egalite_2016.pdf
2 Mélissa Moyser, 8 mars 2017, Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe. Les femmes et le travail rémunéré, Statistique Canada. www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.pdf?st=fEhvaDYu
3 Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique du Conseil du trésor, 2000, Vers une meilleure représentation de la diversité québécoise dans l’administration publique : Rapport sur l’accès à l’égalité en emploi dans la fonction publique québécoise depuis 1980, Gouvernement du Québec. collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1927471
4 Secrétariat du Conseil du Trésor, nd, « Programmes et mesures d’accès à l’égalité en emploi », consultée le 24 septembre 2018. www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/pro…
5 Catherine Paquette, août 2018, entrevue téléphonique avec Diane-Gabrielle Tremblay.
6 Selon la Confédération des syndicats nationaux, le taux de présence des femmes était de 1,91 % en 2017. Confédération des syndicats nationaux, 19 mai 2017, « Encore loin des objectifs à atteindre ». Communiqué de presse. www.csn.qc.ca/actualites/encore-loin-des-objectifs-a-atteindre/
7 Patricia Lewis et Ruth Simpson, 2012, « Kanter Revisited: Gender, Power and (In)Visibility », International Journal of Management Reviews, vol.14, no.2, pp.141‑58. doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00327.x
8 Sheila M. Puffer, mai 2004, « Introduction: Rosabeth Moss Kanter’s « Men and Women of the Corporation and the Change Masters » », The Academy of Management Executive (1993-2005), vol.18, no.2, pp.92-95. www.jstor.org/stable/4166065
9 Janice D. Yoder, 1991, « Rethinking Tokenism : Looking beyond numbers », Gender and Society, vol.5, no.2, pp.178-192. www.jstor.org/stable/189483
10 Catherine Paquette, août 2018, entrevue téléphonique avec Véronique De Sève.
11 Alexa Conradi, 2017, Les angles morts. Perspectives sur le Québec actuel, Les Éditions du remue-ménage, Québec.
12 URelles, 5 juillet 2018, diffusé par CHOQ.ca, Montréal. itunes.apple.com/ca/podcast/urelles/id1409755040?mt=2

par Catherine Paquette | Juin 3, 2017 | Analyses
Il y a d’abord eu, cet hiver, une tempête d’annonces de la part des institutions de financement, qui souhaitent faire davantage de place aux films par des femmes. Puis, au printemps, la création du premier festival de films féministes de Montréal. Le vent tourne pour les femmes au cinéma, mais est-ce pour de bon?
Au Québec, toute œuvre conçue par un ou une cinéaste et nécessitant un financement de plus d’un million de dollars est soumise à un long processus de sélection. L’œuvre doit d’abord être lue et encouragée par – au minimum – un producteur ou une productrice, un télédiffuseur ou un distributeur avant d’atterrir chez la SODEC ou Téléfilm Canada, où un jury chargé d’évaluer les films selon plusieurs critères choisira de lui attribuer ou non une part de son budget annuel.
Or, malgré un nombre équivalent de femmes et d’hommes diplômé·e·s des écoles de cinéma du Québec, les institutions publiques n’accordent pas plus de 20 % du financement disponible aux films produits par des femmes[i]. C’est donc dire qu’elles se limitent, ou se contentent, d’autoproduire leurs films : bien souvent des courts métrages ou des documentaires de peu de moyens. En ce qui concerne le long métrage de fiction, l’organisme Réalisatrices Équitables estime que les femmes reçoivent entre 11 % et 19 %[ii] des enveloppes budgétaires auprès des organismes qui requièrent l’engagement d’un producteur ou d’une productrice, d’un distributeur ou d’un télédiffuseur.
« En cinéma, il n’y a pas beaucoup de chance pour les nouveaux, et encore moins pour les nouvelles, commente Isabelle Hayeur, présidente de l’organisme Réalisatrices Équitables en entrevue avec L’Esprit libre. Tant que tu travailles avec tes ami·e·s sans un gros budget ça va, c’est quand tu commences à aller voir les producteurs [et productrices] que les difficultés peuvent commencer. »
Obstacles à la diffusion
La réalisatrice Magenta Baribeau s’est butée à de nombreux obstacles même après l’aboutissement de certains de ses projets : s’il lui a été difficile de faire financer ses projets en raison de la « sensibilité » de leurs sujets, il a été tout aussi ardu de les diffuser.
Le financement, qui occupe une grande place dans la réussite d’un projet, a aussi un impact dans la diffusion de l’œuvre, une fois terminée.
« Diffuser un film quand t’as pas eu de financement, c’est pas facile, parce que le fait d’être financée donne de la crédibilité. Si j’avais fait un film financé et vu par des personnes ouvertes a des femmes féministes j’aurais eu une plus grosse vitrine », explique Mme Baribeau.
Pour contrer le problème, et parce que l’idée d’un festival plus inclusif lui faisait envie, la cinéaste a fondé le premier festival de films féministes de Montréal. Un festival ouvert à tou·te·s – femmes, hommes, trans – à condition que le sujet du film se rattache au féminisme. Car à ses yeux, en festival, la présence de films par des femmes est toujours insuffisante au Québec.
La première édition du festival a fait salle comble, et elle ne sera pas la dernière, promet Magenta Baribeau, qui est bien déterminée à faire des films dont les sujets touchent les femmes et à encourager les projets de collègues qui font de même.
Vent de changement
Les choses pourraient changer pour les femmes avec les nouvelles mesures qu’imposeront les principales institutions de financement public.
Constatant les difficultés auxquelles les femmes font face dans le milieu du cinéma, l’Office national du film (ONF)[iii], la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)[iv], Téléfilm Canada[v] et le Fonds des médias du Canada (FMC)[vi] ont tour à tour annoncé au cours des derniers mois des mesures qui permettront de tendre vers la parité du milieu.
L’ONF disait l’an dernier vouloir atteindre la parité en annonçant que la moitié de ses films seraient réalisés par des femmes[vii]. Le 8 mars 2017, le président, Claude Jolicoeur, est allé plus loin. D’ici 2020, l’ONF vise à ce que 50 % des monteurs et monteuses, directeurs et directrices photo, scénaristes et autres créateurs et créatrices clefs soient des femmes[viii].
Les autres institutions vont dans le même sens : la SODEC, Téléfilm Canada et le Fonds des médias, qui financent des projets déposés par des producteurs et productrices et télédiffuseurs, demandent désormais qu’un plus grand nombre de projets de femmes leur soient soumis.
C’est donc dire que les producteurs et télédiffuseurs seront fortement incités à aller chercher de nouveaux talents, et à soumettre les films de différentes personnes à ces institutions.
« On sent que le vent est en train de tourner. Je pense qu’on est présentement à un grand tournant pour l’industrie. Ça va remonter la valeur des films de femmes aux yeux de tous ces producteurs [et productrices] », affirme à L’Esprit libre Lucette Lupien, qui a consacré une partie de sa vie à la défense des femmes en cinéma, notamment en tant que porte-parole du comité revendicateur Moitié Moitié dans les années 1980.
30 ans de lutte
Il y a en effet de quoi se réjouir, affirme Mme Lupien, mais tou⸱te⸱s doivent se rappeler que ces revendications ne datent pas d’hier et qu’il est important de considérer les vrais projets de femmes, et pas seulement les films dont seulement quelques-uns des postes sont occupés par des femmes.
Alors qu’Elvis Gratton : Le king des kings prenait l’affiche au Québec (en 1985), la cinéaste collectait les statistiques : à l’époque, pas plus de 16 % des réalisateurs et réalisatrices étaient des femmes. C’est donc dire qu’en plus de 30 ans, ce pourcentage a bougé de seulement 4 points, selon des données qu’elle a conservées depuis.
À l’époque, elle avait fondé avec quelques collègues le comité Moitié Moitié, qui réclamait justement une meilleure répartition du butin dans l’industrie du cinéma. Le comité a fait sa marque dans le milieu, sans toutefois porter fruit auprès des institutions.
« Notre grande fierté, c’est d’avoir sensibilisé les gens. Mais à l’époque, personne ne nous croyait. On était la cible des masculinistes, les gens nous disaient que ces chiffres étaient faux. On nous avait présenté la statistique selon laquelle 60 % des films étaient faits par une réalisatrice, une scénariste ou une productrice. Mais qu’une femme y ait travaillé n’en fait pas nécessairement un film de femme », explique Mme Lupien.
Chose certaine, il faudra quelques années avant de pouvoir mesurer les effets de ces nouvelles politiques de sélection des œuvres.
QUELQUES CHIFFRES
Fonds des Médias du Canada[ix] :
En moyenne, les femmes constituent :
17 % des réalisateurs et réalisatrices
34 % des scénaristes
39 % des producteurs et productrices
des projets dans lesquels le FMC investit.
Office national du film[x] :
Pour l’année 2016-2017, les femmes constituent :
43 % des réalisateurs et réalisatrices
27 % des scénaristes
24 % des monteurs et monteuses
12 % des directeurs et directrices photo
13 % des créateurs et créatrices de musique originale
des projets que l’ONF produit.
Statistiques colligées par le comité Moitié Moitié (document fourni par Mme Lucette Lupien, membre fondatrice du comité Moitié Moitié) :
En 1984-85 les femmes réalisatrices ont reçu 16 % de l’enveloppe totale de production de la SODEC ;
En 1985-86 les femmes réalisatrices ont reçu 22 % de l’enveloppe totale de production de la SODEC ;
En 1989-90 les femmes réalisatrices ont reçu 9 % de l’enveloppe totale de production de la SODEC ;
En 1990-91 les femmes réalisatrices ont reçu 22 % de l’enveloppe totale de production de la SODEC ;
En 1995-96 les femmes ont réalisé 18 % des films avec 8 % de l’enveloppe totale de production de la SODEC.
CRÉDIT PHOTO: Anna Lupien
[i] « Un plan d’action pour atteindre la parité d’ici 2020 », Société de développement des entreprises culturelles, 20 février 2017, http://www.sodec.gouv.qc.ca/plan-daction-atteindre-parite-genres-dici-2020/, consulté le 2 avril 2017.
[ii] « La place des créatrices dans les postes clés de création de la culture au Québec », Rapport de la Journée d’étude sur les femmes créatrices du Québec, 19 mai 2016, http://realisatrices-equitables.com/wp-content/uploads/2016/06/rapport-l…, consulté le 28 mai 2017.
[iii] « Journée des femmes 2017 : L’ONF pousse encore plus loin son engagement pour la parité », Blogue de l’Office national du film, 7 mars 2017, http://blogue.onf.ca/blogue/2017/03/07/femmes-2017-onf-engagement-parite/, consulté le 2 avril 2017.
[iv] « Un plan d’action pour atteindre la parité d’ici 2020 », Société de développement des entreprises culturelles, 20 février 2017, http://www.sodec.gouv.qc.ca/plan-daction-atteindre-parite-genres-dici-2020/, consulté le 2 avril 2017.
[v] Téléfilm Canada, « Téléfilm Canada annonce en partenariat avec l’industrie l’adoption de mesures sur la parité hommes-femmes dans le financement de la production cinématographique », CNW Telbec, 11 novembre 2016, http://www.newswire.ca/fr/news-releases/telefilm-canada-annonce-en-parte…, consulté le 2 avril 2017.
[vi] « Parité femmes-hommes dans le financement de contenu audiovisuel », Fonds des médias du Canada, 27 avril 2016, http://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/nouvelles-et-evenements/actualites/parite-fe…, consulté le 2 avril 2017.
[vii] « L’ONF va financer 50% de projets de femmes », Radio-Canada, 8 mars 2016, http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_de_pointe_toronto/2013-2014…, consulté le 2 avril 2017.
[viii] « Journée des femmes 2017 : L’ONF pousse encore plus loin son engagement pour la parité », Blogue de l’Office national du film, 7 mars 2017, http://blogue.onf.ca/blogue/2017/03/07/femmes-2017-onf-engagement-parite/, consulté le 2 avril 2017.
[ix] « Le FMC annonce des initiatives pour augmenter la contribution des femmes », Fonds des médias du Canada, 8 mars 2017, http://cmf-fmc.ca/fr-ca/news-events/news/march-2017/cmf-announces-initia…, consulté le 28 mai 2017.
[x] « Journée des femmes 2017 : L’ONF pousse encore plus loin son engagement pour la parité », Blogue de l’Office national du film, 7 mars 2017, http://blogue.onf.ca/blogue/2017/03/07/femmes-2017-onf-engagement-parite/, consulté le 2 avril 2017.
Sujets :
Cinéma
hommes-femmes
téléfilm canada
SODEC
égalité
télévision
tournage

par Catherine Paquette | Juil 2, 2016 | Analyses
Un nouveau festival d’humour bat son plein dans un bar de Rosemont, où se succèdent devant le public curieux pas moins d’une soixantaine d’humoristes de la relève. Ils ont pour la plupart entre 20 et 30 ans, et probablement déjà trépigné d’envie de rejoindre leurs idoles d’enfance sur la scène Juste pour rire. Mais c’est maintenant avec l’idée de sortir des sentiers battus qu’ils gravissent les marches de la petite scène aménagée par le Medley à l’occasion du Minifest, un festival auto-produit.
François Tousignant, humoriste à l’origine du Minifest, avait l’ambition de créer un nouvel espace de diffusion pour ses collègues et amis, libre des contraintes qu’imposent de plus grosses machines de production.
«Avec les gros producteurs, c’est vraiment la mentalité de la NHL [Ligue nationale de hockey]. Ils vont te repêcher pour que tu présentes dans une grande salle. On dirait qu’au fil des ans, le lien de pouvoir entre les artistes et le producteur s’est renversé. La production semble dire: « on a pas besoin de toi, c’est toi qui a besoin de nous si tu veux te produire ». Avec le Minifest, on veut leur donner la chance de jouer, mais aussi rappeler aux artistes que l’auto-production est un beau format, que ça peut fonctionner», affirme-t-il.
Mouvement
Depuis quelques années, Juste pour rire n’est plus le principal producteur sur la scène de l’humour au Québec. Mais le milieu reste extrêmement petit: le Zoofest à Montréal et ComediHa! à Québec sont les principales options des artistes qui souhaitent rejoindre un large public.
Au moment où lui est venue l’idée de lancer le nouveau festival, François Tousignant ne s’attendait pas à un tel enthousiasme de la part de ses collègues et amis, malgré un mouvement déjà amorcé vers les modes de production indépendants.
«Ça fait déjà quelques années que dans le milieu de l’humour on entend parler des gens qui essaient de se partir un collectif ou un festival indépendant. [Beaucoup d’humoristes sont] dans une mentalité d’auto-production, parce que ça ne nous prend pas grand chose pour faire un show», raconte-t-il.
Aux yeux de plusieurs, le Minifest arrive dans le monde de l’humour à un moment où les humoristes tentent effectivement de se rapprocher de leur public et faire leur chemin autrement.
«Sans nécessairement boycotter les plus gros, il y a une scène underground qui évolue. À un moment donné, le show business est saturé un peu, alors il y a une relève qui, pour survivre, crée sa propre scène. Il y a plus de bons numéros a l’année longue que Juste pour rire peut en absorber», témoigne l’humoriste Fred Dubé.
L’humoriste Gabrielle Caron voit quant à elle ce mouvement comme une évolution naturelle du monde de l’humour.
«Il faut qu’on réalise qu’il n’y a pas que Juste pour rire, on peut faire autre chose. Ce n’est pas comme dans les années 90 où tu faisais un gala et tu étais une vedette. Ce n’est plus le cas. Maintenant, tu peux faire 8 galas et t’es même pas une vedette. Les choses ont changé et c’est correct que les formules changent aussi», lance-t-elle.
Contraintes financières
Lors de ce festival qui dure six jours, les humoristes inscrits se produisent sur la scène du bar, et récoltent en moyenne 60% sur les revenus de la soirée. Le seul intermédiaire entre le public et les artistes est la billetterie.
«L’auto-production permet d’aller chercher un plus gros pourcentage pour les artistes et de se rapprocher de leur public. Le public peut aussi payer moins cher», explique François Tousignant.
Alors qu’il faut habituellement payer des frais d’inscription pour se produire lors de festivals de plus grosse envergure – le Zoofest par exemple, coûte à partir de 350$ – le Minifest est gratuit pour les artistes.
Des humoristes qui ne souhaitent pas être nommés ont affirmé à L’Esprit Libre que certaines boîtes de production, en plus de cumuler des frais d’inscription, demandent à l’artiste de fournir le matériel publicitaire tel que les affiches et mettent «énormément de pression» pour la vente des billets.
Ces contraintes ont suffi à certains d’entre eux pour cesser de faire affaire avec les plus gros, malgré la visibilité qu’ils apportent.
Contenu explosif
Outre le Minifest, d’autres petits festivals sont nés dans les dernières années, avec également pour but de faire un pied de nez aux grosses boîtes.
Fred Dubé a participé à la mise sur pied, avec Guillaume Wagner, du Front commun comique, où tous les fonds des spectacles à thématiques engagées vont à une cause choisie pour l’occasion.
Le Dr Mobilo Aquafest également de Guillaume Wagner, tenu au mois de mars, a aussi repoussé les normes établies en ayant pour but de rendre l’humour trash davantage accessible.
«Ils éliminent des intermédiaires donc l’artiste est plus libre, a plus d’emprise. C’est une plus grande autonomie donc C’est beaucoup plus intéressant au niveau du contenu, affirme Fred Dubé au sujet des productions indépendantes.
«Beaucoup penchent vers [l’autoproduction]. Ça permet une plus grande liberté pour les humoristes, pour créer ce qu’ils veulent», renchérit Antoni Remillard, diplômé de l’école nationale de l’humour en 2015.
«Avant, il devait y avoir 7-8 one man show par année. En ce moment il y en a une quarantaine par année, mais pour le même public, donc vendre les billets c’est rendu pratiquement impossible. Il faut changer ses méthodes et passer plus par les petites salles. L’auto-production permet aussi de créer des spectacles plus rapidement et de se renouveler plus facilement quand on n’est pas pris dans un carcan d’une grosse production», ajoute-t-il, disant avoir besoin tant des festivals indépendants comme le Minifest que des plus gros comme le Zoofest pour faire son chemin.
Écosystème
Car s’il est facile d’opposer le Minifest au Zoofest par leur mode de production, l’idée derrière les deux festivals reste de donner une vitrine à la relève et à un humour «différent». Le mot clé, selon Patrick Rozon, directeur du Zoofest, est variété.
«Le Zoofest, le Minifest, Dr Mobilo, tout ça fait partie d’un écosystème où on peut travailler tout le monde ensemble. Tu ne peux pas qu’avoir qu’un seul festival d’humour. Il faut juste trouver chacun sa ligne et sa niche qui peut se démarquer dans son style», affirme le producteur.
À la barre du Zoofest depuis deux ans, le directeur décrit le festival comme un événement multidisciplinaire. Il reconnaît qu’il en coûte davantage aux artistes pour se produire lors du Zoofest, mais avec quelques avantages.
«Oui, il y a un aspect financier, mais il y a aussi l’aspect qu’on a un marché d’agence, de diffuseurs, qui vient voir les show et qui peuvent voir des humoristes et aimer ce qu’ils font.
On a l’avantage d’avoir une grosse notoriété dans le marché, et une ambiance qui s’étend sur 24 jours», nuance Patrick Rozon.
Bien qu’il reconnaisse cet avantage qu’ont plusieurs gros festivals, pas seulement le Zoofest, François Tousignant mise tout de même sur le Minifest pour «faire pression sur les festivals et producteurs et construire un meilleur système plus avantageux».
Si dérider le public et se faire connaître est le principal objectif des humoristes, peu importe où ils se produisent, il n’y a nul doute que derrière le Minifest se cache également un « manifeste », celui des artistes voulant innover pour produire un contenu hors-norme.