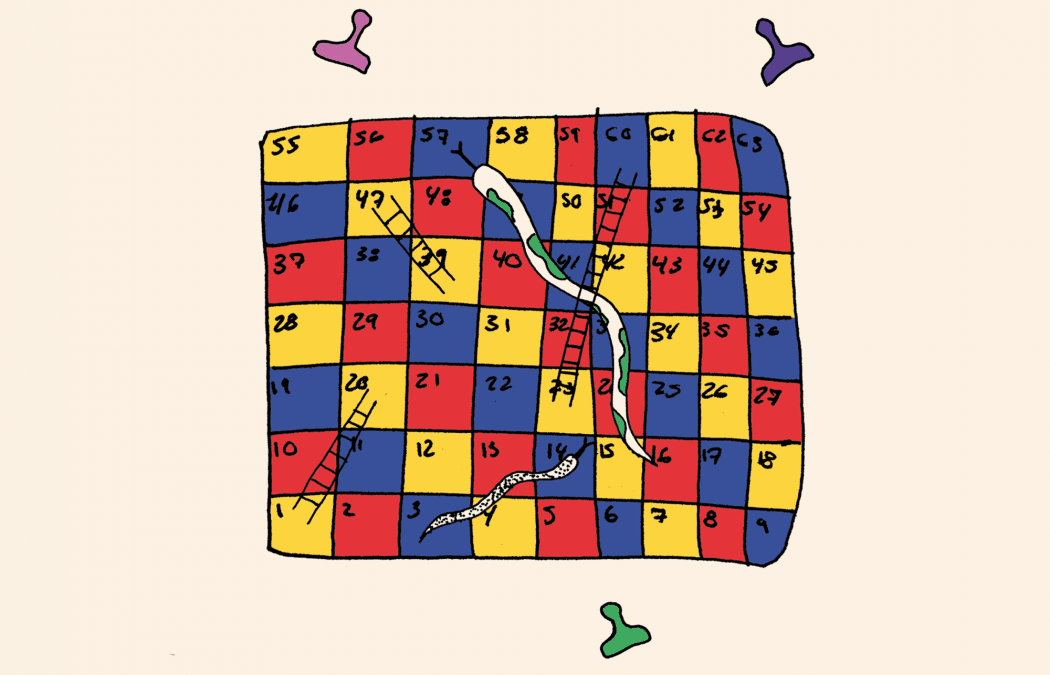par Alexandre Legault, Léo Fays | Oct 19, 2022 | Feuilletons, Societé
Ce texte est extrait du cinquième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
Nous avons rencontré Julien Voyer lors d’un après-midi d’automne sur l’avenue Shamrock à Montréal, récemment réaménagée avec de larges trottoirs, de nombreuses tables, un îlot de cuisine et des plantes. Julien est sociologue et chargé de projet au Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM).
***
Siggi : Merci d’avoir accepté notre invitation, Julien. Première question : qu’est-ce qu’un sociologue peut bien faire dans un centre d’écologie urbaine?
Julien Voyer (JV) : Quand on sort de la sociologie académique, on se demande si ce que l’on a appris va nous être utile, si ce sera valorisé à l’extérieur des murs de l’université. J’ai eu une très belle surprise quand on m’a offert un premier stage au Centre d’écologie urbaine de Montréal. Il y avait des personnes avec des compétences en urbanisme ou en graphisme qui avaient soumis leur candidature. Pour ma part, je n’avais aucune expérience dans le monde de l’aménagement, mais le Centre voulait quelqu’un avec des connaissances sur les inégalités sociales et, surtout, une capacité à mener des enquêtes.
Siggi : Pourrais-tu nous parler un peu du Centre d’écologie urbaine?
JV : Dans les années 1970, des militantes et des militants ont pris part au « mouvement de Milton Parc » à Montréal contre la destruction de maisons patrimoniales par un promoteur immobilier. Le mouvement a été une réussite : on a obtenu la création d’un immense réseau de coopératives d’habitation, un réseau qui est toujours le plus grand au Canada. Ces mêmes personnes se sont impliquées dans d’autres causes, écologistes notamment, et ont contesté une vision de l’urbanisme où l’on planifie tout sans les citoyens et citoyennes. Elles ont créé le Centre d’écologie urbaine dans les années 1990 afin d’aider les membres des coopératives d’habitation à prendre le tournant écologique, par exemple en créant des toits verts ou en aménageant des potagers collectifs.
Le Centre puise ses racines dans ce qu’on a appelé la « nouvelle gauche canadienne ». Dès son origine, le Centre était un organisme militant qui revendiquait la participation citoyenne, pensée à l’aune des dynamiques d’inégalités qui structurent la ville. Ses membres ont tenté d’enclencher la transition écologique – il y a déjà 25 ans! – et ont eu foi en l’action collective. Ce n’est sûrement pas un hasard qu’un tel organisme ait été intéressé par un profil comme le mien, avec des compétences en recherche sur les inégalités sociales.
Siggi : Quel est ton rôle dans cet organisme?
JV : Je suis « chargé de projet et développement ». C’est un peu jargonneux… En gros, ça veut dire que j’élabore un projet de A à Z. Il faut d’abord penser à un projet en phase avec nos valeurs d’urbanisme participatif, puis faire des demandes de subventions et, enfin, le mettre sur pied, ce qui implique une logistique et une stratégie de communication. Parfois, on est sollicités par des municipalités qui ont besoin d’être accompagnées lors d’un exercice d’urbanisme participatif; la plupart du temps, c’est nous qui élaborons des projets et sollicitons les communautés. Par exemple, un des grands chantiers sur lequel mes collègues travaillent actuellement est celui du dépavage. On a reçu une subvention du gouvernement provincial pour soutenir des acteurs et actrices qui désirent dépaver de l’asphalte et créer des espaces verts.
Siggi : Pour t’occuper de quel projet as-tu été initialement embauché?
JV : À la base, j’ai intégré le Centre dans le cadre d’un stage sur « l’urbanisme tactique ». Il y avait alors un grand projet qui s’appelait « Transforme ta ville ». C’était un appel à projets citoyens. Plein d’organismes, d’un peu partout à Montréal, soumettaient leur candidature. Ils disaient « nous, on veut créer un potager urbain » ou « nous, on aimerait créer de l’art dans des stations d’autobus ». L’urbanisme tactique, c’est agir à petite échelle avec la conviction que les citoyens et les citoyennes peuvent mettre en place des solutions pratiques à leurs problèmes. C’est une sorte « d’acupuncture urbaine ». Une multiplicité de projets ont été réalisés, plus de 60, toujours soutenus par de petites sommes d’environ 500 dollars. Avec des petites interventions, on peut mener à de grands changements. Quand je suis arrivé, tout avait déjà eu lieu et le CEUM voulait que j’aille interviewer des personnes qui avaient réalisé ces installations. Le but était de réfléchir avec elles à l’impact de leur projet sur les inégalités sociales. Par exemple, il y avait des membres de la Maison des jeunes de Côte-des-Neiges qui avaient fait un projet en partenariat avec des jeunes d’une communauté autochtone et qui me racontaient comment, à travers l’art urbain, ils avaient créé des liens entre leurs communautés.
Siggi : Y a-t-il un lien direct entre la participation citoyenne à ces projets d’aménagement et la réduction des inégalités sociales?
JV : C’est une question difficile. D’un côté, quand on crée des projets participatifs, on parvient à faire émerger une diversité de points de vue et de besoins. Donc déjà, d’une certaine manière, on réussit à renverser un peu le paradigme dominant dans lequel seules certaines personnes en position d’influence aménagent l’espace urbain. D’un autre côté, il est certain que cette approche a ses limites. Qui vient aux séances de participation citoyenne? Qui vient aménager l’espace urbain dans ses temps libres? Souvent, ce sont des gens assez privilégiés. On en a tout à fait conscience. On déploie beaucoup d’effort pour essayer de créer des démarches qui soient le plus inclusives possible. Par exemple, on sélectionne des plages horaires en dehors du temps de travail ou bien on mène des processus en ciblant des organismes communautaires qui offrent des services à des populations précises, de manière à les inclure dans les projets. On réfléchit constamment à ces types de leviers afin de rendre les processus participatifs plus inclusifs.
Siggi : Pourquoi nous as-tu donné rendez-vous sur l’avenue Shamrock, dans la Petite Italie?
JV : Le CEUM a reçu plusieurs mandats de la Ville de Montréal dans le cadre d’un programme d’implantation de « rues piétonnes et partagées ». Depuis l’adoption d’une Charte du piéton en 2006, il y a toute une réflexion sur l’espace accordé aux automobiles qui est sous-utilisé. Il y a parfois un grand écart entre l’usage réel d’une rue, majoritairement empruntée par des piétons, et l’espace alloué, majoritairement aux voitures. La Ville de Montréal veut donc développer des « rues piétonnes et partagées », c’est-à-dire des rues où l’espace est divisé de manière plus équitable.
C’est délicat de transformer une rue… Si on prend une artère comme celle sur laquelle on se trouve et que, du jour au lendemain, on y installe de larges trottoirs, on retire des espaces de stationnement et on réduit la circulation automobile, il va y avoir une levée de boucliers.
Siggi : On ne se trouve pas sur une rue conventionnelle. Est-ce dire que le projet de transformation a réussi?
JV : Dans une des premières phases du projet, une partie de la circulation a été fermée pour faire place à des installations temporaires, comme un jeu de pétanque et un carrousel. Il y a eu une forte opposition. Des résident·e·s ne voulaient vraiment pas de ces aménagements-là. C’est alors que la Ville a fait appel au CEUM. On a créé un comité de résident·e·s et on a établi un dialogue, afin d’entendre les besoins et souhaits de tout le monde concernant l’espace public en question. L’année suivante, ce sont d’autres types d’aménagements qui ont été testés, comme des tables à pique-nique. Les gens qui s’opposaient au projet en sont tout d’un coup devenus les défenseur·e·s! Je m’explique : ils n’étaient pas nécessairement contre l’idée d’une rue partagée, ils étaient contre certains types d’aménagements. Une fois qu’on les écoutait, qu’on prenait le temps de discuter lors d’un processus citoyen, ils devenaient très attachés au projet. On voit bien comment l’urbanisme participatif permet de créer un engouement et d’inclure les gens dans un mouvement d’aménagement.
Siggi : C’est intéressant ce que tu dis : on entend rarement parler de « l’usage réel des rues ». Si l’on en croit les critiques des transformations urbanistiques des dernières années, c’est comme si tout était pensé pour les piétons et les cyclistes. Mais ce que tu es en train de dire, c’est qu’il s’agit plutôt de rééquilibrer les rues où l’espace accordé aux voitures est plus grand que son utilisation réelle.
JV : Chaque rue est un contexte différent et on a besoin d’études pour comprendre ce contexte-là. Il y a une phrase d’Enrique Peñalosa, ancien maire de Bogota, qu’on aime bien au Centre : « On en connaît beaucoup sur les bons habitats pour les tigres de Sibérie, mais très peu à propos de ce qu’est un bon habitat urbain pour l’homo sapiens. » Ce qu’il veut nous dire par là, c’est qu’on mène très peu d’études sur l’utilisation des espaces publics dans les villes. Pour être en mesure de lutter contre le pouvoir de l’anecdote, contre le pouvoir des médias sociaux où l’on met de l’avant des discours voulant que l’on soit envahi·e·s par les installations piétonnières, on a besoin de données. On a besoin de montrer que telle intervention a par exemple permis à plus de gens d’emprunter une rue à pied en toute sécurité. Je pense par exemple à la rue Jean-Brillant, près de l’Université de Montréal (UdeM) : avant d’implanter une rue partagée, le gouvernement municipal a réalisé des graphiques en pointes de tarte à partir de nos données afin de montrer l’écart entre le partage de l’espace et le débit réel de piétons. Plus de 90 % des usager·ère·s sont des piéton·ne·s alors que moins de 30 % de l’espace permet de circuler à pied. Ça leur a permis de justifier un réaménagement, de dire « voyez, il y avait un déséquilibre, le partage de la rue n’est pas équitable ».
Le CEUM souligne qu’on a besoin de ces données-là. Je pense que c’est là un esprit sociologique, bien qu’un peu positiviste : se dire « on va aller dans les rues voir ce qui se passe réellement » puis amener son petit calepin, son chronomètre et faire des décomptes. On est alors capables de montrer que des réaménagements ont des impacts directs sur l’utilisation de l’espace.
Siggi : Quand tu étudiais la sociologie, est-ce que tu t’imaginais faire ce genre de travail?
JV : Je n’avais pas nécessairement pensé travailler en aménagement pour un organisme à but non lucratif. Par contre, étudiant, j’étais assez impliqué politiquement. J’ai participé à fonder le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles à l’UdeM. J’ai aussi été impliqué dans un syndicat. Mes études ont toujours été liées à la création d’actions collectives. En ce sens, il y a assurément une continuité entre mon métier et mes études.
Siggi : Jeune Julien ne serait pas si surpris alors!
JV: Exact! (Rires.)
CRÉDIT PHOTO: Alexandre Legault
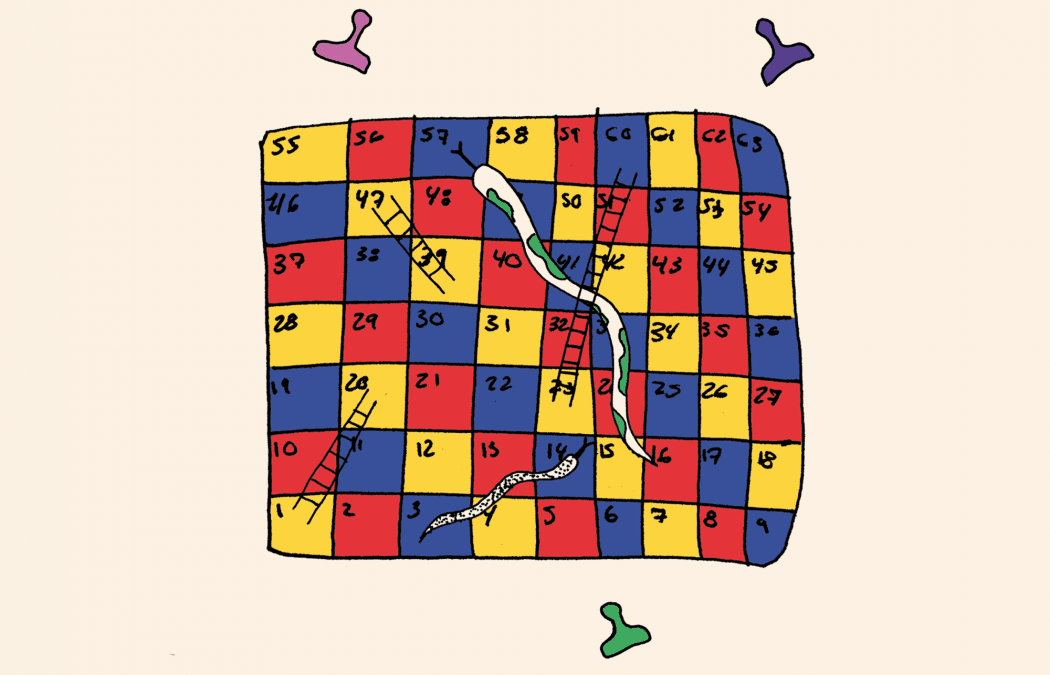
par Alexandre Legault | Nov 6, 2021 | Feuilletons, Societé
Ce texte est extrait du troisième numéro du magazine de sociologie Siggi. Pour vous abonner, visitez notre boutique en ligne!
À chaque parution, un·e professeur·e nous donne une brève leçon dans son domaine de spécialisation. Pour le présent numéro, nous avons rencontré Charles Blattberg, professeur de philosophie politique au Département de science politique de l’Université de Montréal. Il nous expose ici les liens entre esthétique et théories du complot.
Siggi : Depuis quelques années, vous vous intéressez à l’antisémitisme et aux théories du complot qui y sont souvent associées. Dans un article paru récemment[1], vous affirmez que les théories du complot sont amusantes. Pouvez-vous expliquer votre point de vue à nos lectrices et lecteurs?
Charles Blattberg (CB) : Oui, avec plaisir. Il me semble utile d’aborder les théories du complot en parlant de jeux. Il est assez évident que, lorsque nous jouons, nous devons respecter certaines règles. Si nous nous demandons pourquoi nous les respectons, la réponse est toujours : « Juste comme ça. » Il n’y a pas d’autres raisons qui le justifient, mis à part que c’est comme ça qu’on joue. C’est parce qu’un jeu est comme un monde fermé sur soi dans lequel les règles sont suivies pour elles-mêmes.
C’est ici que je fais le parallèle avec les théories du complot. Même s’il existe souvent des fins extérieures à celles-ci — on peut penser à des stratégies psychologiques ou des objectifs politiques —, je dirais que, d’emblée, les personnes qui les inventent ou qui y adhèrent sont là pour les mêmes raisons que les joueurs ou les joueuses : d’abord et avant tout pour s’amuser. Voilà ce qui me semble peu reconnu : qu’il est très amusant de formuler ou d’adhérer à une théorie du complot, de la même manière qu’inventer ou jouer à un jeu de casse-tête.
Siggi : Dans vos recherches, vous proposez une compréhension fondamentale des théories du complot à partir de leur métaphysique.
CB : Mon approche de l’étude des théories du complot met avant tout l’accent sur l’ontologie, une branche de la métaphysique qui s’intéresse à ce qui est. Avant d’aller plus loin, il est important de distinguer trois dimensions de l’ontologie, qui nous seront utiles pour comprendre la suite. Il y a d’abord l’esthétique, qui est le domaine dans lequel se situent — comme c’est le cas avec le jeu — les fins intrinsèques qui sont agréables à réaliser. Ensuite, le naturel : il regroupe les entités qui existent en soi, y compris la part instinctive des êtres vivants qui vise la survie. Enfin, il y a le pratique, qui se rapporte à nos intérêts pour pouvoir bien vivre. Si, dans les dimensions du naturel et du pratique, nous retrouvons souvent des fins de type fonctionnaliste, l’esthétique renvoie plutôt à des motivations désintéressées. C’est donc dans cette sphère que je situe les théories du complot.
Siggi : Comment pouvons-nous définir les théories du complot du point de vue de la métaphysique?
CB : On peut concevoir les phénomènes esthétiques comme à la fois atomistes et monistes — et c’est justement le cas, je crois, avec les théories du complot. Je m’explique. On peut imaginer la dimension esthétique comme une sphère fermée, dont le tout est indépendant et détaché du reste de l’existence : on dira donc qu’il s’agit d’un tout atomiste. Il y a aussi, à l’intérieur, une grande cohésion entre toutes ses parties. C’est la raison pour laquelle la plupart des phénomènes esthétiques peuvent être considérés comme monistes, le monisme étant défini comme un système dont les éléments peuvent être réduits à une seule chose, une unité.
Il s’agit de différences très importantes par rapport au pratique et au naturel. Contrairement à la sphère fermée de l’esthétique, ces deux domaines n’ont pas de frontières nettes avec le reste de l’existence : si on voulait tracer une ligne de démarcation autour d’eux, elle serait pointillée ou floue. Le pratique et le naturel sont aussi davantage marqués par la fragmentation que l’unicité.
Siggi : Ce qui veut dire qu’on peut définir une théorie du complot comme fermée sur elle-même, et à l’intérieur de laquelle tout est connecté?
CB : Tout à fait. Beaucoup de chercheuses et de chercheurs parlent du fait que ces théories sont auto-obturantes (self-sealing), donc « étanches », ce qui explique pourquoi il est souvent très difficile, voire impossible, de démontrer aux adeptes qu’elles sont fausses. La théorie « fonctionne » toujours parce qu’il est impossible de la remettre en cause en invoquant des données extérieures; l’auteur ou l’autrice se retrouve donc bien « protégé∙e » à l’intérieur. Ces gens aiment montrer comment tout ce qui les intéresse est connecté, comment il n’existe pas de fissures dans leur théorie, donc comment toutes ces choses sont liées les unes aux autres d’une façon systématique.
Siggi : On comprend que l’adhésion aux théories du complot n’est pas qu’une affaire de manque d’éducation ou d’intelligence. Vous mentionnez d’ailleurs dans votre article que beaucoup d’intellectuel∙le∙s ont participé à la production de la propagande antisémite en Allemagne nazie. Qui est plus susceptible d’y adhérer?
CB : Disons que les personnes qui sont attirées par la complexité, qui aiment trouver des solutions aux casse-têtes, sont aussi souvent attirées par les théories du complot. Malheureusement, nous aussi, les intellectuel∙le∙s, en faisons trop souvent partie. On dirait qu’il s’agit d’un risque professionnel; c’est une tendance, une tentation. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle, en philosophie, l’élaboration des théories est à la base de la tradition dominante. En revanche, les philosophes qui suivent une tradition plus pratique — en visant la compréhension par l’interprétation plutôt que la théorie — ont peut-être plus d’humilité intellectuelle. Elles et ils reconnaissent que, la plupart du temps, ce qui est devant nous n’est pas un casse-tête à résoudre, mais plutôt un phénomène difficile à saisir. C’est toujours un défi en soi, puisqu’il n’y a pas de solution parfaite.
Siggi : On sait que les théories du complot sous-tendent une vision paranoïaque du monde. Cela n’entrerait pas un peu en contradiction avec l’affirmation selon laquelle elles sont amusantes?
CB : Voilà une excellente question. J’avoue que vous mettez le doigt sur une possible faiblesse dans mon approche. J’ai encore beaucoup de questions à résoudre en ce qui a trait à la fantaisie et à l’épistémologie. Cela dit, je peux proposer cette piste : il existe des émotions comme la peur qui ne sont normalement pas très agréables, n’est-ce pas? On pourrait toutefois parler d’une esthétisation de ces émotions, qui les rend plus amusantes et attrayantes. Par exemple, lorsqu’on regarde un film d’horreur, on est là, assis sur la chaise dans le cinéma, très confortable; il n’y a pas de véritable danger, bien que ce qui se déroule sur l’écran soit évidemment effrayant. Ce qu’on ressent n’est donc pas la peur au sens sérieux ou pratique, mais une version esthétisée de cette émotion. De cette façon, la « peur » et sa cousine, la paranoïa, peuvent devenir attrayantes, esthétiquement parlant. Elles sont agréables.
Bien sûr, il faut pourtant reconnaître que nous avons parfois de bonnes raisons d’être paranoïaques, tout comme il existe de vrais complots dans la réalité. Cela dit, les théories du complot sont le plus souvent des produits de la fantaisie, et je dirais que dans un tel cas la paranoïa sera ressentie comme une forme de jouissance. Dans mon article, je donne l’exemple de certains nazis qui avaient du plaisir à ce que leurs victimes les trouvent effrayants. Ce n’est donc pas seulement leur émotion qui est rendue esthétique, mais également la peur qu’ils inspirent aux autres. C’est pour cette raison que je suis en désaccord avec l’énoncé de Hannah Arendt, dans son fameux texte Eichmann à Jérusalem (1963), selon lequel le mal peut prendre une forme banale. Au contraire, il me semble que quelqu’un qui s’amuse, qui profite de la peur qu’il inspire aux autres, n’est pas un banal fonctionnaire, mais un vrai méchant, un monstre même.
Siggi : Si les théories du complot relèvent essentiellement de l’esthétique, comme un jeu ou une fantaisie, comment expliquer leurs conséquences, leurs effets réels?
CB : Je crois que les gens qui suivent ou qui inventent des théories du complot sont des esthètes. Ils vivent leur vie, de façon consciente ou non, selon l’esthétisme : une conception qui réduit toute la réalité à la dimension esthétique. On retrouve même cette approche chez certains philosophes, comme Nietzsche ou Heidegger (même si ce dernier rejetterait complètement cette étiquette). Évidemment, probablement comme vous aussi, je rejette l’esthétisme parce que je fais la distinction entre l’esthétique, le naturel et le pratique.
Pour revenir à votre question, les esthètes ne feront pas la distinction entre le plaisir que procure le jeu, par exemple, et toutes les autres activités pratiques et naturelles de la vie. Et c’est justement parce que ces gens veulent juste s’amuser qu’ils sont si dangereux. S’ils croient que la vie est comme un jeu, ou une pièce de théâtre — pour citer Shakespeare : All the world’s a stage, and all the men and women merely players (tout le monde est un théâtre et tous les hommes et les femmes ne sont que des joueurs) —, alors il leur sera difficile de prendre le monde au sérieux, ou même d’être sensibles à la souffrance des autres.
Siggi : Pourtant, lorsqu’on observe les gens qui adhèrent à des théories du complot, on remarque tout de suite qu’ils veulent être pris au sérieux, qu’on reconnaisse leurs convictions. Certains parlent même d’une quête de vérité. Ne seraient-ils pas en désaccord avec la comparaison de leurs théories à des jeux?
CB : Veulent-ils être pris au sérieux? Je dirais oui et non. Comme je l’ai suggéré, les esthètes ne sont pas du genre à être sensibles à la distinction entre le sérieux (ce qui est pratique ou naturel) et le non sérieux. Je crois qu’ils et elles veulent surtout être reconnu·e·s pour un autre mode de l’esthétique : celui du spectacle. Après tout, ils et elles veulent être acclamés pour avoir trouvé la solution à un puzzle important. Un scientifique sérieux ou une scientifique sérieuse, au contraire, est quelqu’un dont le travail est motivé par des fins pratiques — même si ce n’est qu’indirectement —, donc qui peut potentiellement contribuer au bien-être général. C’est ça, prendre au sérieux ses idées. Oui, les personnes qui inventent des théories du complot veulent qu’on soit d’accord avec elles, qu’on reconnaisse qu’elles ont trouvé la solution à un problème complexe, mais je ne dirais pas que ce sont des gens sérieux au sens strict.
Siggi : Vous apportez une nuance intéressante dans votre article : vous dites que ces gens ne croient pas à leurs théories, mais y « croient », entre guillemets. Qu’entendez-vous par là?
CB : Encore une fois vous mettez le doigt sur un aspect de la question qu’il me reste à approfondir. Cet aspect est plus épistémologique qu’ontologique : quelle est la signification de ces guillemets? Je pense qu’ils représentent justement une façon d’indiquer que l’on parle de quelque chose qui est esthétique, et non pas naturel ou pratique. D’ailleurs, il est fascinant d’observer comment les enfants reconnaissent facilement cette distinction. Je me souviens de la première fois, lorsque mon fils de quatre ans a dit : « Non, papa, je ne veux pas dire ça, je veux dire « ça ». » (Geste des doigts pour signifier les guillemets.) Je me suis même demandé comment il avait appris à faire ça, sans être au courant de toute la philosophie derrière! (Rires.) Mais sérieusement, j’ai beaucoup appris sur l’esthétique en échangeant avec mes enfants, puisque les enfants sont — Dieu les bénisse — des esthètes. Quand ils ne dorment pas, ils suivent presque toujours les principaux modes de l’esthétique : jouer pour s’amuser, s’adonner à la fantaisie, faire des spectacles et savourer la beauté.
Pour revenir à notre propos : dans le cas de l’antisémitisme, par exemple, il n’est donc pas question des Juifs, mais plutôt des « Juifs », c’est-à-dire de l’image ou de la figure du Juif qui, souvent, n’existe que dans l’imagination de l’antisémite. Ce n’est pas par hasard si l’antisémitisme se répand souvent dans des pays où il n’y a pas de population juive considérable. Je dirais aussi que saisir ce que l’on entend par les guillemets est aussi la meilleure façon de comprendre comment les théoriciens et théoriciennes du complot « croient » à leur théorie. Ils et elles n’y croient pas dans le sens d’une philosophie pratique, pour mieux interpréter une réalité, ou comme une ou un scientifique qui veut étudier un phénomène naturel. Non, ils et elles y « croient » puisque ça « fonctionne » pour leurs fins esthétiques qui, finalement, renvoient à la jouissance.
Siggi : En fin de compte, un ou une esthète ne serait donc pas capable de faire la différence entre croire et « croire »?
CB : Tout à fait, c’est un très bon résumé de ce que je voulais dire.
Siggi : Pour conclure, diriez-vous qu’il faut se méfier d’une théorie amusante, ou d’une belle théorie?
CB : Au moins au début, oui. Parce que c’est peut-être un signe qu’on simplifie la réalité. Cela dit, je dois préciser que je parle ici de phénomènes que l’on retrouve dans la dimension pratique, qui est normalement plus fragmentée que le naturel. Évidemment, pour une physicienne ou un autre scientifique de la nature, c’est leur travail de formuler des théories qui fonctionnent, et elles fonctionnent parfois très bien. Par contre, lorsqu’il s’agit de la dimension pratique — de la philosophie, des sciences sociales, de la psychologie, etc. —, dès que l’on croit avoir réussi à formuler une théorie qui est très belle, et même amusante, je dirais que c’est un signe que l’on est probablement à côté de la plaque!

par Alexandre Legault | Sep 27, 2019 | Feuilletons
Au sujet de la gentrification à Leipzig, une ville allemande post-communiste, un auteur écrivait avec regret qu’elle avait perdu son âme, et avec elle son « wabi-sabi ». Dérivant de principes bouddhistes, le wabi-sabi est une disposition d’esprit qui vise à accepter avec sérénité – voire à apprécier – l’impermanence et la désuétude des bâtiments historiques. Il rappelle une attitude générale et un rapport à l’architecture que j’ai souvent rencontrés chez les jeunes adultes leipzigois. Un d’entre eux, nommé Tillman, en offrait un exemple éloquent, lorsqu’il m’a parlé de son arrivée à Dresde il y a une dizaine d’années. Originaire d’une petite ville ouest-allemande près de Stuttgart, il raconte qu’il a senti le besoin de se rendre en Allemagne de l’Est après la réunification du pays. Il en parle comme un moment excitant, dans des termes qui évoquent une transcendance lorsqu’il mentionne le paysage urbain :
When I came to Dresden the first time at the main station, I thought “oooh, it’s another planet”! And the people, and all the space, so many free space! Yeah, 30% of the city left, it was empty. And that was for me not possible, I couldn’t imagine that before.
Similairement, la plupart des gens que j’ai côtoyés – des collègues de l’université ou bien des artistes qui faisaient partie de leur cercle d’amis – avaient une sorte de fascination teintée de romantisme pour les vieux blocs à appartements et les manufactures décrépites ; une réminiscence de l’époque de la République démocratique allemande (1949-1990). Lorsque je me déplaçais à vélo avec Paul, un autre de mes amis leipzigois, il nous arrivait à l’occasion de nous arrêter et de regarder un moment un vieux bâtiment abandonné au milieu d’un champ, qui semblait pouvoir s’effondrer d’un instant à l’autre. C’est un type de paysage qui résonnait avec lui, propice à la rêverie et la nostalgie, mais qui en retour engageait une réaction cynique : « Probably these blocks will be renovated into fancy condos for the rich. It’s so sad. »
Certains quartiers autrefois hautement désirés par ce groupe d’amis, comme Plagwitz, le « coin des artistes », sont maintenant des endroits qu’ils veulent éviter. Peut-être est-ce dû à la présence de plus en plus importante de bâtiments rénovés ? À Plagwitz, aux graffitis sur les vieux bâtiments qui apparaissent sans planification, on opposait l’art mural professionnel des nouvelles boutiques ou bien la peinture fraiche sur les immeubles résidentiels. Un autre ami de la place m’a dit que certaines entreprises ont un contrat pour repeindre par-dessus les graffitis aussitôt qu’ils réapparaissent. Certains commerces tentent de reproduire en vain l’ambiance post-industrielle du quartier ; d’autres, en revanche, s’y opposent en tout point. C’est le cas d’un nouveau restaurant, ouvert depuis deux ans. Sa clientèle est en général plus âgée que mes connaissances du coin, la plupart étant des nouveaux nantis qui s’y rendent en voiture de luxe, ou bien des touristes. « Look at them », me dit Paul en me montrant un homme bien vêtu accompagné de sa femme, « it’s like they have no style at all ! » À l’intérieur, les gens peuvent manger et boire dans un décor aseptisé sur fond de musique lounge. C’est un style neutre qu’on retrouve partout dans le monde et qui, outre la langue sur les menus, ne laisse pas d’indices spécifiques sur l’histoire et la localité.
Le nouveau coin vers lequel on dirige les espoirs pour l’art et l’aventure est dorénavant le quartier de Neustadt situé à l’Est de la ville, dont une rue a la réputation d’être « la plus dangereuse » de Leipzig – du moins c’est ce qu’on répète souvent. Par comparaison, Neustadt n’est pas aussi développée, elle compte aussi moins d’immeubles rénovés. C’est l’endroit où vivre si on veut s’éloigner de tout ce qui se rapporte à l’esthétique de la nouveauté. Une grande banderole est accolée sur l’immeuble abandonné en face de l’appartement de Tillman, sur laquelle on peut lire : « Ausbauhaus », ce que je traduirais librement par « maison à rénover ». Tillman m’explique que des logements sont libres pour être loués à prix modiques si les locataires sont prêts à tout rénover et aménager (cuisine, salle de bain, salon, chambres à coucher), ce qui mène souvent à des appartements peu peaufinés et à l’apparence détériorée ; une esthétique pourtant appréciée par mes amis à Leipzig. Après tout, les paysages urbains, à la fois dans leur composantes extérieures et intérieures, ne sont pas que des espaces fonctionnels, mais aussi des décors sur lesquels on projette des conceptions de la vie et qui, parfois, entrent en collision avec d’autres.
CRÉDIT PHOTO: Alexandre Legault